 Les Journaux de Sylvia Plath montrent le lien indéniable entre la vie et l’œuvre de la poétesse et romancière américaine, devenue une icône à la suite de son suicide à l’âge de 30 ans. L’une nourrissant l’autre et vice versa, participant de la fascination qu’elle exerce. C’est ainsi que ses journaux des années 1950 à 1962 (le carnet relatant les dernières années de sa vie jusqu’en 1963 ont été détruits par son mari Ted Hughes) nous offrent une superbe antichambre de son travail de création littéraire et poétique. Mais aussi de ses années de formation en tant qu’étudiante de Smith College puis de Cambridge, la vie universitaire, ses voyages en Europe puis plus tard ses débuts d’enseignante, sa vie à Boston… Bien évidemment, sa vie amoureuse rythme aussi les pages de cette jeune-fille puis jeune femme avec comme point d’orgue sa rencontre avec le poète Ted Hughes, leur mariage et leurs deux enfants. L’auteur nous livre ses tourments, doutes, attentes, ambitions de jeune écrivain en devenir tout en ne cessant de lutter contre ses démons avant d’y succomber… Pièce fondamentale de son œuvre, les journaux de Sylvia Plath constituent une perspective unique des affres de la création et d’une vie intérieure bouillonnante à la sensibilité rare :
Les Journaux de Sylvia Plath montrent le lien indéniable entre la vie et l’œuvre de la poétesse et romancière américaine, devenue une icône à la suite de son suicide à l’âge de 30 ans. L’une nourrissant l’autre et vice versa, participant de la fascination qu’elle exerce. C’est ainsi que ses journaux des années 1950 à 1962 (le carnet relatant les dernières années de sa vie jusqu’en 1963 ont été détruits par son mari Ted Hughes) nous offrent une superbe antichambre de son travail de création littéraire et poétique. Mais aussi de ses années de formation en tant qu’étudiante de Smith College puis de Cambridge, la vie universitaire, ses voyages en Europe puis plus tard ses débuts d’enseignante, sa vie à Boston… Bien évidemment, sa vie amoureuse rythme aussi les pages de cette jeune-fille puis jeune femme avec comme point d’orgue sa rencontre avec le poète Ted Hughes, leur mariage et leurs deux enfants. L’auteur nous livre ses tourments, doutes, attentes, ambitions de jeune écrivain en devenir tout en ne cessant de lutter contre ses démons avant d’y succomber… Pièce fondamentale de son œuvre, les journaux de Sylvia Plath constituent une perspective unique des affres de la création et d’une vie intérieure bouillonnante à la sensibilité rare :
« (…) j’ai entrepris d’aller à la pêche dans l’océan immobile, stagnant et putride mais potentiellement riche de mon subconscient. »
L’intérêt premier des journaux de Sylvia Plath réside dans les coulisses de ses œuvres à venir qu’elle expose ici, en particulier de ses poèmes mais aussi de son unique roman « La cloche de détresse ».
Directement inspirés de sa vie, tous ses écrits sont en effet en profonde résonance avec les différents évènements et anecdotes qu’elle consigne dans ses journaux. A commencer par sa tragique tentative de suicide à l’âge de 19 ans qu’elle évoque à demi-mots et qui sera au cœur de la cloche de détresse. Son unique roman sur lequel elle travaille avec ardeur (et douleur) et qu’elle veut être « le témoignage définitif d’une génération ». Il est très intéressant de suivre sa réflexion sur sa construction narrative, ses recherches : « Voir chaque scène dans toute sa profondeur, la traiter amoureusement comme un joyau aux multiples facettes. Trouver la lumière, l’ombre et la couleur vive. Déterminer la scène la veille au soir. Puis dormir dessus et l’écrire le matin. » Elle évoque aussi les conseils d’une écrivain (Val) qui la prend sous son aile : « la visualisation d’abord, et ensuite seulement l’émotion. Les écrivains débutants partent des impressions, des sens, et oublient la froide organisation réaliste. Il faut d’abord froidement mettre au point l’intrigue objective. Avec rigueur. Ensuite, écrire le truc, après un moment passé sur le divan pour le visualiser, le chauffer à blanc, le faire revenir à la vie – la vie de l’art, la forme et non plus l’informe, sans système de références ». Une mine pour tous les apprentis-écrivains !
Sa passion littéraire est chantée sur toutes les pages : « Comment pourrais-je dire à Bob que tout mon bonheur vient d’avoir réussi à avoir arraché un morceau de douleur et de beauté à ma vie, pour en faire des mots dactylographiés sur du papier ? Comment pourrait-il savoir que les voir imprimés justifie ma vie, mes émotions intenses, mes sentiments ? »
Une visite chez un tatoueur ou encore un oisillon recueilli chez elle, anecdotes du quotidien, se transforment ainsi en poèmes remarquables. Ou comment le matériau brut de la vie se transforme en art.
Mais ce sont aussi et surtout ses conceptions de l’écriture, de l’art romanesque ou poétique qu’elle cherche à théoriser qui sont plus particulièrement passionnantes. On découvre comment elle a façonné son style et trouvé sa voix(e) littéraire, sa singularité : « Je dois cultiver cette bizarrerie et cette intériorité simplement en demeurant en moi-même, et en étant fidèle à mes farfadets et démons personnels. »
De très nombreuses belles phrases sur son processus d’inspiration et de création : « Bourgeonner, se gonfler de la substance, de la texture de la vie, tel est mon travail, ma vocation. Qui donne à mon être, un nom et un sens : « faire de l’instant quelque chose de permanent », « Chacun des sujets me plait profondément. Il faut qu’ils se déposent dans mon esprit, s’incrustent et s’étoffent » .
Et son journal se transforme ainsi en véritable manifeste littéraire : « Ecrire est un acte religieux, une manière d’ordonner, corriger, réapprendre et réaimer les gens et le monde, tels qu’ils sont et pourraient être. Créer une forme qui ne se perd pas, contrairement à un jour de dactylographie ou d’enseignement. Le texte écrit, reste, voyageant de son côté dans le monde. (…) On a le sentiment de rendre la vie plus intense – on donne plus, on scrute, on interroge, regarde et apprend, on crée cette forme, et on reçoit plus en retour : monstres, réponses, couleur et ligne, connaissance. »
Même si elle ne peut s’empêcher de douter en se comparant aux célébrités littéraires de l’époque, en particulier les abonnés aux best-sellers « de second ordre » ou encore à jalouser leur productivité : « Il faut oublier à présent les histoires qui se vendent. Ecrire pour rendre une humeur, un incident, et s’il y a de la couleur et du sentiment, cela devient une histoire. Donc essayer de se souvenir : … Ne pas manipuler l’expérience, mais la laisser se déployer et se reconstituer, dans ses associations ténues et spécifiques, que l’esprit logique court-circuiterait. » Un dilemme d’hier qui trouve encore toute son actualité aujourd’hui.
« Ce que je redoute le plus je crois c’est la mort de l’imagination. Quand dehors le ciel est tout simplement rose et les toits tout simplement noirs : cette disposition photographique de l’esprit, qui paradoxalement dit la vérité sur le monde, mais une vérité sans valeur. (…) Si je ne bouge pas et si je ne fais rien, le monde continue de battre comme un tambour mal tendu, dépourvu de sens. (…) La pauvreté d’un monde sans rêves est inimaginable tant elle est affreuse. C’est cette folie qui est la pire. L’autre celle avec des visions et des hallucinations, serait un soulagement (…).
 On découvre aussi ses influences littéraires : Virginia Woolf (à propos de qui elle écrit : « Ses romans rendent les miens possibles » et D.H Lawrence en tête (avec qui la filiation est flagrante), en passant par Joyce, Henry James ou encore Faulkner, Ionesco… : « Et soudain la totalité ou plutôt la plus grande partie de ce long chapitre de 35 pages qui devrait être (pour les évènements au moins) le cœur de mon roman me semble facile et banale : ce bavardage théâtral à propos des portes, des murs, du vent, tout cela valsant dans tous les sens. Alors que ce devrait être l’équivalent psychique de toute l’expérience. Mais comment font Woolf et Lawrence pour transcrire tout cela ? Il faut que j’accepte d’apprendre de ces deux là. De Lawrence, pour la richesse de la passion physique – champs où s’exercent les forces- et pour la présence réelle, pleine de sève, des feuilles et de la terre, des animaux, du temps qu’il fait. Et de Woolf, pour cette luminosité névrotique et asexuée – sa manière de saisir les objets, chaises, tables, silhouettes au coin de la rue, et de leur infuser un éclat – miroitement du plasma de la vie. »
On découvre aussi ses influences littéraires : Virginia Woolf (à propos de qui elle écrit : « Ses romans rendent les miens possibles » et D.H Lawrence en tête (avec qui la filiation est flagrante), en passant par Joyce, Henry James ou encore Faulkner, Ionesco… : « Et soudain la totalité ou plutôt la plus grande partie de ce long chapitre de 35 pages qui devrait être (pour les évènements au moins) le cœur de mon roman me semble facile et banale : ce bavardage théâtral à propos des portes, des murs, du vent, tout cela valsant dans tous les sens. Alors que ce devrait être l’équivalent psychique de toute l’expérience. Mais comment font Woolf et Lawrence pour transcrire tout cela ? Il faut que j’accepte d’apprendre de ces deux là. De Lawrence, pour la richesse de la passion physique – champs où s’exercent les forces- et pour la présence réelle, pleine de sève, des feuilles et de la terre, des animaux, du temps qu’il fait. Et de Woolf, pour cette luminosité névrotique et asexuée – sa manière de saisir les objets, chaises, tables, silhouettes au coin de la rue, et de leur infuser un éclat – miroitement du plasma de la vie. »
Amusante aussi sa référence à Philip Roth (alors jeune débutant dont on oublie qu’il est de sa génération !) dont elle lit « Goodbye Colombus », le premier recueil de nouvelles (qu’elle trouve « captivant et divertissant »).
C’est enfin sa rage de réussir, son obsession de reconnaissance et de célébrité qu’elle tente de combattre au profit de l’écriture en tant que telle. Avec le cycle infernal de l’attente impatiente et nerveuse des réponses du New-Yorker ou du Ladies home journal pour publier ses poèmes et nouvelles. Et en fonction de ses précieuses lettres qu’elle guette la promesse d’un état de félicité ou de profonde morosité… « Mon manuscrits de poésie m’est revenu à pas lourds » décrit-elle avec une certaine auto-dérision noire.
Artiste et mère de famille : la difficile conciliation…
Autre thème majeur et récurrent de ses journaux (et également de « La cloche de détresse ») : son tiraillement permanent entre les deux rôles qu’elle souhaite jouer, celui d’artiste, d’écrivain et celui d’une mère de famille et de fée du logis. S’ajoute aussi un autre paradoxe : « sa part masculine » comme elle la nomme (elle jalouse d’ailleurs la liberté des hommes) et en même temps son envie de dévouement à un homme (comme celui qu’elle aura pour Ted Hughes), ce qui rappelle beaucoup Anaïs Nin (qu’elle n’évoque curieusement jamais) : « Je pourrai par exemple fermer les yeux, me boucher le nez et sauter aveuglément dans un homme, me laissant recouvrir par les eaux de son fleuve, jusqu’à ce que ses buts deviennent les miens, sa vie la mienne,etc. Un beau jour je remonterai à la surface en flottant, totalement noyée et ravie d’avoir trouvé ce nouveau moi sans moi. » ou encore « Je voudrais une vie conflictuelle, un équilibre entre les enfants, les sonnets, l’amour et les casseroles sales. », « Et je me disais holà, attention, tu vas te réfugier dans les domestique, et suffoquer en tombant tête la première dans un bol de pâte à biscuits. »
Elle cultive aussi une grande réticence face à la maternité (autre point commun avec Anaïs Nin qui choisira l’avortement) dont elle tentera d’apprivoiser l’idée au fil des années : (le bébé) « le pire absolu, hormis les mutilations physiques, maladies et morts, ou la perte d’un amour ». Elle entretient d’ailleurs à l’égard de sa mère une relation complexe entre admiration et mépris, jalousie, rancœur et culpabilité (elle développe la thérapie qu’elle fait sur ce sujet sur plusieurs pages, assez fastidieuses du reste ; à noter que le recueil « Letters home » contient sa correspondance avec sa mère).
Une jeunesse américaine dans les années 50 : les années de formation
Les journaux de Sylvia Plat retracent aussi ses années de formation et d’apprentissage en tant qu’étudiante de Smith College puis de Cambridge. Elle témoigne de la difficulté des choix scolaires, de sa soif d’apprendre et de tout connaître. Un formidable appétit de connaissance l’habite. Mais aussi les soirées, les beuveries de la vie universitaire…
Ce sont encore ses voyages en Europe (Angleterre, France, Italie…), jobs d’été, de baby sitting jusqu’à ce qu’elle débute en tant qu’enseignante (elle se moque notamment des « dynasties d’étudiantes » qui courtisent certains profs) ou occupe d’autres emplois comme celui de standardiste dans un hôpital psychiatrique. Un autre dilemme, propre aux écrivains, la déchire encore à ce propos : celui d’exercer une profession dans le civil (qui nourrit l’inspiration mais consomme aussi l’énergie vitale) ou se consacrer à ses écrits : « Je ne veux pas d’emploi tant que je ne suis pas satisfaite de mon travail d’écrivain – et pourtant j’ai désespérément envie d’avoir un emploi – d’être remplie par la réalité extérieure – celle où les gens acceptent que les notes de téléphone, les repas à préparer, les enfants, le mariage fasse partie du dessein du monde. »
Une certaine insouciance et joie de vivre flottent mais sans cesse rattrapées par son tyran intérieur (« ses dieux accusateurs, toujours insatisfaits, qui m’entourent comme une couronne d’épine ») qui la pousse à travailler davantage, à tirer vers l’excellence. A la façon d’un coach mental, elle se dresse des listes de tâches à accomplir, de connaissances à acquérir (apprendre l’allemand, la botanique, les cartes, lire du français…), de projets à mener… « Une litanie de rêves, de directives et impératifs« .
Une introspection lucide
Elle n’hésite pas à s’accuser, se remettre en question en permanence. Elle se définit ainsi comme « une pragmatique machiavélique » ou maudit ses « emballements hystériques », sa soif d’être aimée… Faisant preuve d’une grande lucidité sur elle-même, elle est en permanence en quête de sa vérité dont ses journaux sont les outils ou encore ses analyses psychiatriques. « Le psychiatre est le dieu de notre époque. Mais il coûte cher » note-t-elle avec un humour à la Woody Allen ! Elle tente ainsi de résister à l’angoisse, la folie qui guette, « l’oiseau de panique » comme elle les surnomme.
« Chaque pensée est un démon, un enfer (…) ! (…) Paralysée, amère, tu regardes le monde te claquer les portes les unes après les autres. Ah, ce secret que tu possédais jadis, d’être joyeuse, de rire, d’ouvrir des portes, tu l’as oublié »
Mais hormis quelques rares allusions (« Je veux me tuer pour fuir toute responsabilité, rentrer en rampant dans le ventre maternel »), le spectre du suicide n’apparaît pas vraiment dans ses pages où dominent plutôt un appétit de vivre, la passion littéraire et le bonheur marital.
Un regard acéré sur son entourage
C’est avec tout autant de discernement qu’elle observe et analyse ses rapports aux autres : « Dans ma sollicitude pour les autres êtres humains, quelle est la part sincère et vraie, quelle est la part du vernis imposée par la société, de l’affectation, je n’en sais rien. J’ai peur de me regarder en face. » On se régale aussi de ses portraits sur le vif de son entourage, hommes ou femmes : « James, un homme brisé, le visage anguleux, le teint jaune, et sa physionomie sympathique faite de tous ces traits noirs striés – cheveux, sourcils, rides, grain sombre de la peau rasée, et les yeux noirs rieurs – tout cela semblait brisé, de guingois. »
Ou encore du récit de ses diners en ville et autres mondanités dont elle se plaint parfois : « J’en ai assez des dîners, de ce prix fixé socialement qu’il faut payer et rendre, en donnant de plus en plus de soi-même, et ça je n’en peux plus. »
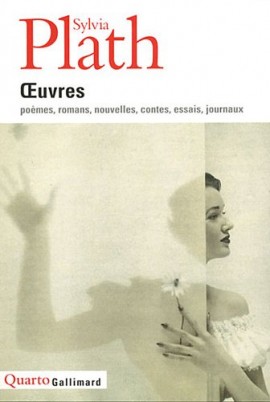 De l’éducation sentimentale au mariage…
De l’éducation sentimentale au mariage…
« L’amour est une illusion mais j’y succomberais bien volontiers si je pouvais y croire », écrit avec malice Sylvia dans son journal d’adolescente. On suit ainsi sa quête du grand amour, de son futur mari, pressée par sa mère qui la menace de finir vieille fille. Elle évoque par petites touches un tourbillon de garçons qui compteront plus ou moins pour elle jusqu’à ce Ted Hughes rencontré dans une soirée londonienne, les éclipse tous. Ils se marieront seulement un an après leur rencontre. Une relation qu’elle décrit comme fusionnelle placée sous le signe de la complicité intellectuelle. Elle lui dédie quelques très belles pages d’amour : « Je sens bien que je possède miraculeusement, une chose impossible, merveilleuse : Ted et moi sommes parfaitement en accord, corps et âme, comme dit la chanson ridicule – écrire est notre vocation, chacun est pour l’autre l’amour, et nous avons le monde à explorer. Comment ai-je pu vivre cette époque stérile et désespérée où j’expérimentais et sortais avec les uns et les autres, écoutant ma mère me mettre en garde, dire que j’étais trop critique, que je mettais la barre trop haut et resterais vieille fille. Après tout, ç’aurait peut être été le cas si Ted n’avait pas existé. (…) Féminine, j’aime être entourée et dominée. Mais je peux tuer dans mon esprit tout homme faible, duplice ou pervers (…). Nos besoins se rencontrent et se confondent : solitude, tranquilité, longues promenades, bonne viande, toutes nos journées pour écrire, et un petit nombre d’amis remarquables qui ne jugent jamais sur les apparences. (…) Il prend tout de moi, il utilise tout si bien que je brûle et rayonne d’amour comme un feu, et c’est ce dont je rêvais dans la vie, de pouvoir donner sans réserve mon amour et ma joie spontanée, sans rien garder par peur de mensonges, abus ou trahisons. » En revanche on peut s’étonner que la sensualité soit presque totalement absente de ses journaux, peut-être les passages plus explicites font-ils partie des « omissions » qui jalonnent les pages. Plath était une charnelle comme en témoigne certains élans et fantasmes qu’elle évoque durant sa jeunesse. Une des premières scènes qui ouvre ses journaux est ainsi chargée de ce désir incandescent qui l’habite à l’occasion d’un baiser volé : « Et soudain sa bouche était sur la mienne, dure, véhémente, sa langue s’enfonçant entre mes lèvres, ses bras me serrant comme de l’acier. » ; « je tenais ma main contre ma bouche chaude et meurtrie par son baiser ».
Le contexte politique (guerre de Corée, Vietnam, maccarthisme…) ou même la culture populaire (elle évoque seulement Marilyn Monroe à travers un curieux rêve qu’elle fait sur elle et Arthur Miller) sont presque absents de ses considérations. On a l’impression d’un journal hors du temps (ce qui n’est pas un défaut). Elle évoque seulement son aversion pour l’Amérique (même si elle aime se ressourcer dans ce pays « neuf, brut et grossier »): « L’Amérique toute entière semble n’être une file de voitures en mouvement, avec des gens entassés à l’intérieur, et qui vont d’une station d’essence à un restoroute. »
On est parfois un peu gêné par la chronologie qui passe précipitamment d’une situation à une autre (elle est étudiante puis la page d’après femme mariée, beaucoup d’ellipses…). On est ainsi frustré de ne pas avoir plus d’impressions à l’arrivée de son premier enfant dont l’accouchement n’est même pas mentionné.
Servi par son style très littéraire et imagé, ce journal est riche de magnifiques descriptions, presque exercices de style. Elle donne des couleurs, des consistances à ses sentiments : « cette étrange fatigue verdâtre et visqueuse, écœurante » ou nous enveloppe dans les atmosphères pluvieuses ou neigeuses du Massachusetts, sa région natale « Au lit ayant pris mon bain, avec la pluie bienfaisante qui recommence à tomber – recouvrant d’une couche liquide le toit de bardeaux sous ma fenêtre. Il a plu toute la journée, la pluie nous enserrant dans son humidité. (…) avec tous ses différents timbres et son rythme syncopé. Le bruit –sec et métallique- dans les gouttières sonores. Son rapport à la nature, au ciel, à la lumière est à ce titre très présent et donne à ses pages une grande poésie et émotion sensorielle.
A lire aussi : la chronique de son roman « La cloche de détresse » : Le monde, ce mauvais rêve…













Derniers commentaires