Martin Eden de Jack London est publié en 1909, 7 ans avant qu’il ne meure d’empoisonnement. Considéré comme l’autobiographie romancée (autofiction dirait-on aujourd’hui !) du prolifique écrivain américain, un des précurseurs du « nature writing », et devenu livre culte des aspirants écrivains, adapté en BD en 2016. L’auteur est alors un écrivain reconnu, notamment pour ses récits d’aventures et de nature sauvage (avec en tête « L’appel de la forêt » et « Croc blanc »), plus particulièrement prisés par la jeunesse.

Illustration de l’adaptation BD de Martin Eden (Lapière, 2016)
La critique sociale qui souffle sur toute l’œuvre de cet autodidacte ayant longtemps connu la misère, le vagabondage et les petits boulots à la dure, s’affirme aussi dans ce livre. En racontant l’itinéraire d’un apprenti-écrivain, contre qui tout s’acharne, ce roman de formation brasse de nombreux thèmes sur l’art, la culture, l’instruction, l’amour (entravé par), les classes sociales, les apparences, mais également existentiels avec une certaine portée philosophique. Il revendiquera d’ailleurs avoir écrit cette histoire en protestation contre la philosophie de Nietzsche même si le public aura davantage retenu la dimension autobiographique tandis que les auteurs en herbe y voient une dénonciation du milieu littéraire… L’écrivain Martin Page le citait dans sa bibliothèque idéale comme « le parcours d’un homme, sa lutte contre la fatalité sociale mais aussi un portrait d’artiste« :
La vie volait haut. Sa fièvre ne retombait jamais. Le bonheur de créer, qui était censé n’appartenir qu’aux dieux, était en lui. Et en lui était la vraie vie ; tout le reste, les odeurs de lessive et de légumes pourris, le débraillé de sa sœur et les ricanements de Mr Higginbotham, n’était qu’un rêve. Le monde réel était dans son esprit et les histoires qu’il écrivait en étaient l’expression. »
Martin Eden c’est l’histoire de… Martin, jeune et robuste marin vivant à Oakland (Californie), en pension chez le mari de sa soeur, un commerçant pingre et rustre, qui vivote entre deux embarquements dans les mers lointaines, aimant se bagarrer, s’enivrer et la bagatelle à l’occasion…
Un brave garçon aventureux, amoureux des îles, qui n’a pu étudier et ignore (presque) tout des livres.
C’est alors que le hasard le fera rencontrer un tout autre monde incarné par la figure d’une jeune-femme, Ruth Morse, fille de notables et étudiante en littérature. A l’opposé de son milieu, il est alors subjugué autant par sa grâce que par ce qu’elle représente : le savoir, le raffinement et la culture. Découvrant l’amour pour la première fois, il décide alors de faire son éducation avec son aide et se découvre une vocation d’écrivain. Mais son apprentissage sentimental et littéraire bouleversera sa vie irrémédiablement…
L’idéalisation du monde de la connaissance et de l’élite intellectuelle par Martin Eden
Martin Eden c’est avant tout l’histoire d’un homme qui pousse soudainement les portes du savoir et s’émerveille des trésors qu’il y découvre. Il est littéralement envoûté par ce monde spirituel et intellectuel qu’il dévore et qui lui fait espérer une nouvelle vie loin de la misère et de la brutalité de son milieu. Martin, personnage absolutiste et idéaliste, rappelle les penseurs du siècle des lumières qui voyait en la connaissance le salut de l’humanité, sortant de l’obscurantisme qui jusqu’alors avait régné. Passer d’un « homme primitif » tel qu’il se qualifie, à un homme évolué : « Tu étais une sombre brute et (…) tu croyais, comme les autres, que la virilité se mesurait au nombre de plaies et de bosses qu’on était capable d’infliger à l’anatomie d’autrui. »
Le lecteur est frappé par sa dévotion aux livres auxquels il veut consacrer tout son temps, dans une véritable frénésie boulimique. Un livre en appelant un autre dans une course poursuite sans fin. « Le plus dur était de refermer ses manuels (…) pour clore ses paupières lourdes et se forcer à dormir. L’idée de cesser de lire, même pour une courte durée, lui faisait horreur et sa seule consolation était dans le tic-tac de son réveil, ultime garantie que sa petite mort ne durerait que cinq heures et que bientôt, la sonnerie le tirerait de l’inconscience. Alors, une nouvelle glorieuse journée de dix-neuf heures s’offrirait à lui. » Il est intéressant de suivre l’évolution du personnage au fur et à mesure qu’il s’instruit, sa vision du monde et de la vie qui change.

Illustration de l’adaptation BD de Martin Eden (Lapière, 2016)
Au-delà de son enrichissement intérieur, Martin Eden associe également ce monde de la connaissance à celui de l’élite sociale. C’est par la figure de Ruth, son premier amour, qu’il accède aux livres. Une grande part de la fascination qu’elle exerce sur le héros est due à sa classe sociale (dans un rapport d’attraction-répulsion comme on le verra dans la suite du roman ; on remarque aussi son ambivalence à l’égard des gens de son milieu, entre rejet et tendresse). « Une caste » qui lui semble « inaccessible »
Classe ouvrière et bourgeoisie : le rêve d’ascension social de Martin Eden
Cette bourgeoisie cultivée suscite l’admiration et l’envie du personnage dans un premier temps avant que son vernis ne s’écaille et qu’il découvre sa vraie nature. « Ca me fait (…) envie. Je veux respirer cet air-là, moi aussi, vivre au milieu des livres, des tableaux, des belles choses, avec des gens qui parlent à voix basse, qui sont propres, qui ont des pensées propres. L’air que j’ai toujours respiré sentait la crasse, la pauvreté, la gnôle, la crapule. »
On remarque sa violente opposition entre ces deux mondes, assez manichéenne toutefois même si sa justesse demeure : la classe ouvrière et la bourgeoisie. Plus précisément les travailleurs manuels d’un côté et les intellectuels de l’autre. On est touché par ses réflexions sur la besogne qui éreinte ses proches : le passage sur les mains est à ce titre magnifique. Il est frappé par la main douces « comme un pétale de rose » de Ruth contrairement aux mains calleuses, endurcies, étuvées… des travailleuses manuelles qu’il connaît. « Il revit les paumes rugueuses de sa mère gisant dans son cercueil, et les mains de son père, qui s’était tué à l’ouvrage, racornies comme des manicles de cuir au jour de sa mort. » Ce simple détail en dit finalement plus long que tous les discours sur le fossé qui les sépare comme il le comprendra : « Voila le gouffre qui les séparait. Elle était de ces gens qui n’avaient pas besoin de travailler pour vivre. L’aristocratie oisive lui apparut tout à coup comme une statue d’airain, arrogante et toute-puissante, sur le mur devant lui. Il avait toujours trimé lui, lui; tous ses souvenirs, depuis l’enfance, étaient liés au labeur. Toute sa famille avait peiné à la tâche. »
Ce type d’analyse reste encore manichéenne car les forçats de la vie de bureau existent aussi même si la pénibilité du travail n’est bien sûr pas la même. De plus, Martin Eden est bien placé pour savoir que l’effort intellectuel peut être aussi éprouvant, lui qui se tue à l’étude. Le labeur manuel qui assomme les hommes fait ainsi l’objet d’une description particulièrement saisissante à travers son expérience à la blanchisserie (on se croirait alors presque chez la Gervaise Macquart de Zola !).
La critique socialiste de Jack London dans Martin Eden et littérature engagée
Sous la houlette d’un dénommé Joe, homme qui s’épuise à la tâche et qui boit pour oublier, Martin Eden vit un véritable enfer dans ce travail acharné quasiment inhumain. London s’attarde à décrire longuement la métamorphose qui s’opère alors en lui. Son esprit est littéralement assommé et vidé, perdant toute capacité à penser : « Tout son être était accaparé par son travail. Transformé en automate humain, il concentrait toute son intelligence sur ses gestes et il n’y avait plus de place dans son cerveau pour les grands problèmes de l’univers. Les vastes couloirs de son esprit étaient hermétiquement fermés. La chambre d’écho de son âme était comme une tourelle de commandement, qui transmettait des ordres à son bras, à ses épaules, à ses dix doigts… ». Ou encore : « [Ses pensées], entièrement accaparées par des besognes qui lui rongeaient les nerfs, ne lui appartenaient plus. Il ne pensait à rien. » ; « Son ambition s’était desséchée – et avec elle sa belle vitalité. Il était mort. Son âme était morte. Ce n’était plus qu’une bête, une bête de somme. » ; « Les miroirs visionnaires de son imagination étaient en berne, sesn anciens fantasmes dépérissaient dans une chambre de malade aux volets clos. »
Cette dénonciation de l’exploitation fait écho à l’engagement socialiste de London (qui se retrouve dans plusieurs de ses romans, comme « Le Peuple de l’abîme »). Toutefois, ici Martin Eden est accusé d’être un « horrible socialiste » alors qu’il s’en défend : il se définit comme un individualiste car pour lui l’égalité n’existe pas, c’est un leurre : « Je crois que la course est gagnée par le plus rapide, la bataille par le plus fort. », dans la droite lignée des idées du philosophe Spencer qu’il vénère (tout comme London), forme de « darwinisme social » (« La survie du plus apte »).
Cette dimension philosophico-politique donne lieu à différents débats dans le roman qui auront pu dérouter certains lecteurs d’ailleurs. London verse ainsi dans la littérature idéologique mais le fait avec subtilité ce qui ne gêne -pour une fois !- pas la narration et l’enrichit plutôt habilement.
Martin Eden : une histoire d’amour dans un monde de brutes…
Martin Eden c’est aussi et peut-être avant tout une histoire d’amour… tragique certes, mais qui recèle aussi de beaux moments. C’est en particulier le rapprochement progressif avec Ruth qui est particulièrement touchant. L’attirance de deux êtres que tout oppose et dont la famille fera tout pour les séparer. Air connu mais joué avec une belle sensibilité ici.
L’attirance de Ruth pour cet homme du peuple au physique robuste (comme la référence constante à son cou) loin des dandys délicats de son entourage, qu’elle éprouve sans la comprendre et presque contre son gré, rappelle Lady Chatterley de Lawrence face au garde forestier rustre. On notera par exemple son éveil à la sensualité : « Elle avait dormi profondément et, aujourd’hui, la vie frappait furieusement à sa porte. » De son côté Martin Eden vit un véritablement éblouissement face à cette « fleur d’or pâle » qu’il compare à une divinité ou une déesse. En fait, Ruth lui apparaît comme le symbole de cette culture et ce raffinement auxquels il aspire si fortement (projection) :
« Et pourtant c’était bien une âme qu’il avait vue dans les yeux de cette fille – une âme à jamais immortelle. » C’est ce qui la rend si précieuse à ses yeux, comparativement aux filles du peuple plus « vulgaires » jusqu’à ce qu’il révise son avis (cf : le personnage de Lizzie). Il la voit comme un pur esprit et se refuse à « la confondre avec un banal être de chair » jusqu’à cette fameuse scène des cerises. London décrit avec subtilité l’évolution de leurs sentiments et leur expression charnelle, avec quelques notes d’humour liées à la maladresse ou les craintes du héros.
Quelle femme ne rêverait d’être aimée avec l’ardeur et la dévotion d’un Martin Eden ?! Face à l’effondrement de ses illusions sur l’élite intellectuelle, il s’accroche encore à l’amour qui est à l’origine de sa vocation d’écrivain et de son instruction : « Eh bien il aurait au moins gagné cela : Ruth et l’amour. Tout le reste était un fiasco. Seuls Ruth et l’amour avaient résisté à l’épreuve des livres. Il y voyait une sanction biologique. L’amour était l’expression suprême de la vie. A l’instar de tous les autres hommes, il était fait pour l’amour – ultime dessein de la nature (…). » : son ultime espérance/illusion à laquelle il se raccroche avant qu’elle ne soit aussi brisée… »
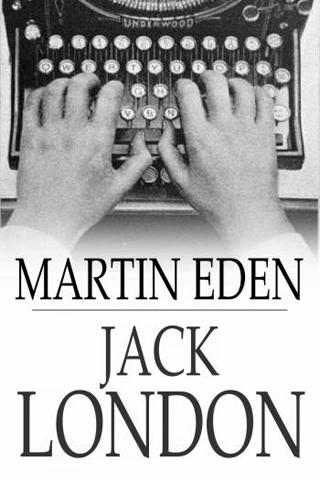
Martin Eden : Le parcours de forçat d’un aspirant écrivain venu du peuple
Deux décennies avant Arturo Bandini, Martin Eden incarne la figure du jeune écrivain qui fait tout pour se faire publier dans les magazines puis chez les éditeurs. Génie incompris à ses débuts, il connaît le ballet incessant des envois et retours de manuscrits et lettres de refus en tout genre, tout en crevant de faim (sa relation avec sa logeuse tout aussi pauvre fait partie est particulièrement attachante également). Mais jamais énergie bouillonnante ni son exaltation littéraire ne faiblissent : London nous fait partager sa boulimie d’apprendre et sa foi inoxydable en son succès futur. London en profite au passage pour régler ses comptes avec la critique littéraire qu’il ne supporte pas : « Les chiens de garde du succès littéraire sont les ratés de la littérature. ». En filigrane, il pose la question du pourquoi vouloir écrire ? : entre carrière et beauté de l’art…, mais aussi les difficultés de la création comme avec cette formidable tirade: « Imbécile ! criait-il à son image dans la glace. Tu voulais écrire, tu essayais d’écrire et tu n’avais rien à dire. Qu’est ce que tu portais en toi ? Deux ou trois idées, quelques sentiments réchauffés, des beautés mal digérées, une énorme masse d’ignorance crasse, un cœur débordant d’amour et une ambition à la mesure de cet amour, mais à l’échelle de ton ignorance. Et tu voulais écrire ! Pardi, mais tu commences à peine à te mettre un peu de matière dans le crâne. Tu voulais créer de la beauté alors que tu ne connaissais rien de la nature de la beauté. Tu voulais écrire sur la vie et tu ne connaissais rien des caractéristiques essentielles de la vie. Tu voulais parler des grands principes qui régissent le monde quand le monde était pour toi un casse-tête chinois auquel tu ne comprenais rien. Mais courage, mon gars ! (…) Un jour, avec de la chance, tu seras très près de connaître tout ce qu’il y a à connaître. Alors, tu écriras. »
Le désenchantement de Martin Eden : La beauté versus l’argent
Mais ce formidable élan et appétit de vie finiront par être brisés… La grande force du roman est de faire intervenir, contre toute attente, ce dégout au moment de son succès. Ce qui l’abat c’est la perte de ses idéaux, de ses illusions : la beauté de l’art et l’amour. Dans un monde gouverné par l’argent, ce qui a de la valeur est uniquement ce qui rapporte de l’argent. Le ralliement de sa bien-aimée à cette vision achèvera de le détruire : « Les hommes de lettres étaient les géants de ce monde, ils étaient infiniment supérieurs à tous les Mr.Butler de la terre avec leur trente mille dollars par an et leurs aspirations à la Cour suprême. » Il dénonce ici le manque d’ouverture d’esprit de la plupart des gens, convaincus que seul leur modèle est valable : « Elle était prisonnière de cette commune insularité de l’esprit qui contraint les créatures humaines, vivant sous d’autres cieux, sont défavorisées par le sort. (…) Ainsi Ruth voulait-elle refaçonner cet homme sorti d’un autre moule à l’image des hommes sortis du même que le sien. » C’est un profond désenchantement sur l’humanité, même si quelques figures féminines, sa soeur, sa logueuse ou encore la jeune ouvrière Lizzie, l’ont toujours soutenu et lui inspirent reconnaissance et respect.
La connaissance fait-elle notre bonheur ?
In fine, on se rend compte que le roman va encore plus loin dans sa réflexion sur l’instruction, le monde des idées et des lettres. Dans cette aventure intellectuelle, Martin a perdu son insouciance, ses joies simples qui le contentaient avant : « Il n’avait plus le cœur assez simple pour vivre pleinement une existence aussi primitive. » Et le retour en arrière est impossible… « Il y avait trop de distances entre eux. Trop de livres les séparaient. Il s’était exilé. Il avait voyagé dans le vaste royaume de l’intellect jusqu’au point de non-retour. »
Ne reste qu’un sentiment de solitude impossible à rompre.
On pense à cette maxime « Heureux les simples d’esprit » : est-ce ce que London a voulu démontrer ?
Il s’inscrit ainsi dans la veine d’un Frankenstein, lui même relié au péché originel biblique et à la chute du Jardin d’Eden (dont le nom de famille du héros semble faire écho…) et autres mythes grecs de Prométhée à Icare… Une questionnemenque l’on retrouve encore en filigrane dans Fahrenheit 451, même si Bradbury décide lui de défendre les livres et la culture contre le procès de mélancolie qu’on leur dresse historiquement.
Tout le savoir accumulé par Martin ne le conduira finalement pas au bonheur mais au contraire au désabusement jusqu’à à une issue fatale. (de façon plus contemporaine, c’est aussi la thèse reprise par Martin Page dans son premier roman, dans le sens inverse : « Comment je suis devenu stupide »). Ce personnage absolutiste, intense, bascule alors d’un extrême à l’autre. Jack London nous dit qu’il y a quelque chose de pire que de ne pas voir ses rêves se réaliser c’est quand ils se réalisent trop tard. Quand la désillusion et la déception ont déjà infusé leur venin trop profondément dans les veines jusqu’à en tarir la pulsion de vie… [Alexandra Galakof]













Derniers commentaires