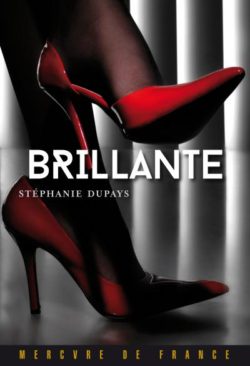 Brillante est le premier roman de la trentenaire Stéphanie Dupays publié en 2016 avec une sortie poche en 2017 qui a rencontré un certain écho (Prix Charles Exbrayat). Comme le laisse deviner sa couverture assez cliché qui semble repompée du diable s’habille en Prada sans en avoir l’humour (cela a d’ailleurs été changé pour la version poche plus réussie, petit détail ayant malgré tout son importance !), s’inscrivant dans le désormais genre bien fourni du roman d’entreprise encore appelé roman de bureau, et aborde plus spécifiquement le cas du harcèlement moral, un sujet d’actualité toujours aussi sensible et critique. On se rappellera que Delphine de Vigan l’avait aussi abordé dans Les heures souterraines à travers un roman choral. Dupays a expliqué, elle, avoir voulu explorer la notion de réussite. On sent que l’auteur dont on ne sait pas grand chose hormis qu’elle est une « haut fonctionnaire dans les affaires sociales » s’est inspirée de sa propre expérience tant des grandes écoles que de son ressenti de la « grande entreprise » dont elle livre au passage une satire… pas forcément très novatrice malheuremsent mais néanmoins qui sonne juste.
Brillante est le premier roman de la trentenaire Stéphanie Dupays publié en 2016 avec une sortie poche en 2017 qui a rencontré un certain écho (Prix Charles Exbrayat). Comme le laisse deviner sa couverture assez cliché qui semble repompée du diable s’habille en Prada sans en avoir l’humour (cela a d’ailleurs été changé pour la version poche plus réussie, petit détail ayant malgré tout son importance !), s’inscrivant dans le désormais genre bien fourni du roman d’entreprise encore appelé roman de bureau, et aborde plus spécifiquement le cas du harcèlement moral, un sujet d’actualité toujours aussi sensible et critique. On se rappellera que Delphine de Vigan l’avait aussi abordé dans Les heures souterraines à travers un roman choral. Dupays a expliqué, elle, avoir voulu explorer la notion de réussite. On sent que l’auteur dont on ne sait pas grand chose hormis qu’elle est une « haut fonctionnaire dans les affaires sociales » s’est inspirée de sa propre expérience tant des grandes écoles que de son ressenti de la « grande entreprise » dont elle livre au passage une satire… pas forcément très novatrice malheuremsent mais néanmoins qui sonne juste.
Le roman Brillante nous plonge une nouvelle fois dans les rouages maudits de l’entreprise et de ses bureaux délétères tant honnis des écrivains. Pour changer, nous avons ici un point de vue féminin, prototype de la jeune cadre dynamique et ambitieuse parisienne à qui tout réussit tant professionnellement que sentimentalement jusqu’à sa chute… Vous rappelez vous au passage le portrait sans concessions, peu flatteur et misogyne de la femme de pouvoir que dressait Bernard Mourad dans Les actifs corporels ? Je me suis amusée à rapprocher les 2 points de vue masculin et féminin (regardez l’extrait ça vaut le détour !).
A travers ce portrait, l’auteur retrace aussi la trajectoire d’une jeune provinciale montée à Paris avec toute la mythologie que cela peut comporter, d’espoirs, de rêves et de fantasmes sur la ville lumières, façon Rastignac. Figure classique revue et revue mais à laquelle elle réussit à donner un peu d’épaisseur même si on regrettera de trouver beaucoup de clichés (même si les clichés font aussi partie de la réalité !).
Monde de l’entreprise et aspirations littéraires
Le roman brasse ainsi de nombreux thèmes et pose notamment un regard critique sur la formation des élites de type HEC où règnent la vacuité intellectuelle et culturelle, la superficialité et où le réseau prime sur tout le reste, à commencer par le savoir et les compétences. Elle oppose ainsi tout au long du roman ce monde capitaliste au monde littéraire culturel incarné par la soeur de l’héroine. L’opposition est assez manichéenne et encore une fois passablement cliché (vous l’aurez compris ce livre pèche pas mal par son côté vu et revu), le choix cornélien entre la sécurité, le confort matériels et l’épanouissement personnel et la liberté rimant avec fins de mois difficiles, sur un air du blues du business(wo)man qui « aurait voulu être un artiste » mais qui n’a pas osé parce que les filières littéraires ça mène au chomage… Et on ne peut s’empêcher encore une fois de penser à l’auteur elle-même, qui semble aussi avoir été cette littéraire contrariée, dans cette situation mais qui finalement aura réussi à concilier les deux !
Le couple, une stratégie marketing comme une autre
Plus réussi, elle aborde toujours avec cynisme ces « power couple » (désolée de l’anglicisme, j’ai vainement essayé de le traduire, si vous avez des suggestions n’hésitez pas ! L’auteur les décrit comme « couple socialement idéal », avez vous déjà vu sur Instagram ces commentaires de jeunes qui en voyant des « influenceuses » poster des photos de leur couple s’exclament « couple goal« , effrayant non ? La nouvelle génération m’inquiète parfois…) de jeunes cadres dynamiques qui gèrent leur couple comme ils gèrent leur carrière : « leur couple qu’ils gèrent comme une entreprise, en équilibrant les actifs risqués et les placements plus sûrs« . Elle épingle leurs manies avec un mordant qui fait souvent mouche. « L’image qu’un couple projette sur autrui, ça compte beaucoup. » Elle brocarde aussi, de façon plus attendue les fameux bobos et leurs goûts conformistes, comme sa description piquante de leurs décos intérieures haussmaniennes toutes calées sur les mêmes stéréotypes et l’exhibition des signes extérieurs de réussite.

Stéphanie Dupays, auteur de Brillante aux éditions Mercure de France
Elle livre aussi bien sûr une peinture acerbe du monde de l’entreprise où les ambitions s’entrechoquent et où l’hypocrisie régne. On s’amusera de ces quelques piques sur les us et coutumes corporate comme : « une arrivée tardive au bureau, vers neuf heures trente ou dix heures est tolérée. C’est le signe qu’on a potassé ses dossiers tard la veille ou qu’« on a une vie ». », le novlangue qui fleurit dans les bureaux et qui dénature le sens des mots et du langage ou encore l’autopromo qu’il faut pratiquer sans relâche pour espérer une promotion…
Le piège du cocon protecteur et paternaliste de l’entreprise
Elle dévoile plus particulièrement ses mécanismes paternalistes plus insidieux qui va lui permettre de fidéliser ses salariés et d’acheter leur dévouement et leur âme : « L’entreprise avait compris que le lien le plus fort n’est pas pécuniaire, il est affectif. Nutribel offrait plus que de l’argent à ses salariés. Elle leur offrait une identité. » ou encore le côté faussement protecteur qu’elle offre : « Plongée dans cet univers, Claire se sent invulnérable. Protégée du lot commun des salariés, immunisée contre l’absence de choix et la lente gangrène de la routine, épargnée par le rouleau compresseur de la recherche d’emploi. » Elle évoque ainsi l’addiction au travail et à la performance dont sont victimes les cadres qui se laissent aspirer entièrement par leur fonction au détriment de toute vie personnelle : « hypnotisée par l’écran de son ordinateur, tout son corps chevillé à cette volonté de faire du bon travail qui, comme une colonne vertébrale, la maintient droite. » ou encore « La vie réduite à des fichiers Word et PowerPoint est tellement plus simple que celle qui vient de se dérouler en trois dimensions dans son salon. »
En dehors de l’entreprise point de salut ni d’identité
Outre la dimension financière c’est donc bien une importance, même une existence sociale que confère l’entreprise comme Dupays le relève finement : « quand Claire prononce la phrase magique, « Claire Vermont, de Nutribel ». La particule « de » dénote l’appartenance à une nouvelle aristocratie, celle de l’entreprise, avec ses hiérarchies, ses préséances, ses codes, une aristocratie accessible aux enfants de la classe moyenne qui ont cru à la méritocratie scolaire et s’y sont accrochés de toutes leurs forces pour s’extirper de la langueur de leur province natale. »
Et forcément par symétrie, la perte de cette fonction et surtout du statut social allant avec, se vit comme une déchéance, une « disgrâce » et une honte ultimes : on est plus rien, on ne vaut plus rien leur semble-t-il. « Avoir un problème au travail, c’est n’être rien, ne plus avoir de raison sociale : inavouable ! Ce sont les « cas soc’ », les « brascass », les has been qui ont des difficultés. Pas elle ! Le dire serait se ranger elle-même dans la catégorie des « personnalités difficiles », des « gens à problèmes ». »
Ce qui arrivera donc à l’héroine.
Le vide est encore plus épuisant que l’urgence.
La description de son harcèlement moral est plutôt bien vu et très précise. L’auteur montre bien comment le processus se met en place insidieusement, les différentes étapes qui vont mener à son exclusion lente, progressive mais bien réelle. Encore une fois l’hypocrisie qui entoure cette « violence en milieu tempéré », sans que jamais rien ne soit dit ouvertement, l’art de mettre hors jeu avec le sourire, les manoeuvres malveillantes et coups dans le dos qui isolent et vous fragilisent au point de vous faire perdre tout repère. Cruel et implacable. Son analyse psychologique est aussi réussie : elle dit bien les doutes, interrogations, tentatives de faire face, de faire bonne figure, de « rebondir » comme elle s’en donne l’ordre, puis le découragement, la honte (sociale, vis à vis de son conjoint, de son cercle d’amis, etc.), la peur qui gagnent face à la messagerie et l’agenda désormais vides de toute tâche et RDV à accomplir jusqu’à ses (vains) appels au secours. Une des scènes les plus réussies est justement celle où l’héroïne décide de rentrer chez elle, ne supportant plus l’osiveté, en plein milieu d’après-midi et le vertige qu’elle en éprouve d’être ainsi désoeuvrée au coeur de l’activité parisienne qui bat son plein.
Sans dévoiler la fin du roman, l’auteur pointe ici, malgré les mesures juridiques, les difficultés encore à faire reconnaître et à résoudre ces situations de mal-être au travail qui restent tabous. Elle montre aussi le dilemme auquel sont confrontés les employés qui se trouvent entâchés par cet ostracisme et préfèrent ne pas faire de vague afin de ne pas « se griller » dans leur milieu. Cela vaut aussi pour le harcèlement sexuel qui marque au fer rouge les femmes qui ont osé porté plainte ou ont parlé… Double peine plus que regrettable et même scandaleuse…
Pour conclure sur ce livre, malgré des points positifs et une lecture plutôt fluide et agréable grâce à la plume alerte de l’auteur et sa construction travaillée, j’avoue avoir été globalement déçue par son contenu qui m’a paru assez convenu et son style un peu trop plat et scolaire. On a du mal à s’attacher à son personnage principal qui reste assez stéréotypé. On a ainsi l’impression de lire la copie peut-être « brillante » d’une bonne élève mais à qui il manque cette sève qui fait les bons livres qui vous marquent vraiment. Pour citer une autre auteur de la même génération, Sophie Divry par exemple m’a plus impresionnée sur ce plan. [Alexandra Galakof]













Derniers commentaires