Le roman « Madame Bovary » de Flaubert (1857) compte parmi les livres qui me hérissent le plus. J’avais immédiatement ressenti un malaise à sa première lecture et un décalage entre la façon dont il est couramment présenté et son contenu véritable. En effet, le livre constitue une affreuse imposture. Il n’est tout simplement pas ce qu’on dit qu’il est. Je ne remets pas ici la qualité stylistique (encore que je trouve beaucoup de lourdeurs dans sa démonstration pesante) mais surtout le sujet, le fond, les idées véhiculées: le livre étant souvent présenté comme l’histoire d’une femme trop « rêveuse », vivant dans le monde imaginaire de ses livres et victime de la fade réalité de sa vie de femme (mal) mariée. De cela est d’ailleurs né le verbe « bovaryser » (confondre la vie avec les livres).

Etalage au rayon parascolaire/bac français du libraire « Gibert jeune » à Paris, où Madame Bovary règne…
Or Emma Bovary n’a rien d’une rêveuse et encore moins d’une lectrice (ses lectures ne sont d’ailleurs quasiment jamais évoquées hormis au cours d’une rapide page railleuse qui moque le caractère « sentimental » des romances qui la fascinaient au couvent, 1e partie, chap.6). Tout est ici prétexte à moquer l’imaginaire féminin et ses émois. Le terme « sentimental » est employé ici dns son acception péjorative (elle était plus « sentimentale qu’artiste », cherchant à opposer les 2 notions et notamment le féminin et le masculin indirectement. Flaubert ne s’en cache pas : il a voulu « montrer les sentiments médiocres« comme le rapporte Bourdieu dans Les règles de l’art). La sentimentalité gâte les idées et énerve les passions. Par contraste, une vraie lectrice (et -grande- femme de lettre), Charlotte Brontë, elle-même écrivait en 1836 à son amie Ellen, que ses rêves dévorants et son « imagination fiévreuse » lui faisaient ressentir la société telle qu’elle était, « désespérément inspide ». Ironiquement, dans L’éducation sentimentale (1869), on trouve une vision revalorisée du sentiment dés lors qu’il s’applique à un personnage masculin, ici le fameux Frédéric Moreau qui se caractérise avant tout par la pureté de ses idéaux même s’il n’est pas dépourvu de défauts.
Au vu de sa carrière et talent, personne ne songerait pourtant aujourd’hui à tourner ce sentiment en dérision, car une sensibilité forte (ce que Zola nommait le « tempérament ») n’est-elle pas le signe d’un grand écrivain et d’un esprit au contraire brillant ? (certes, mais seulement quand il s’agit d’un homme !, nous répondrait probablement Flaubert :-)). Il ne se cachait d’ailleurs pas de ses intentions comme il l’écrivait dans une lettre à Louise Colet: « Ce sera, je crois, la première fois que l’on verra un livre qui se moque de sa jeune première… »
Bref, Bovary est surtout l’occasion de diffuser une idéologique patriarcale bien lourde réduisant la femme à tous ses clichés de petite chose superficielle, petite cervelle vénale, frivole, dépensière, victime de ses « appétits consuméristes » (passant plus son temps à passer commande auprès de son « marchand de nouveautés » Lheureux qu’à lire pour tout dire !), et abonnée à de la littérature considérée comme « bas de gamme » par le canon littéraire patriarcal. Le consumérisme était d’ailleurs considéré comme une tare spécifiquement féminine et réprouvé dés lors par les moralistes (en particulier les achats liés à la mode qui donnait aux femmes une forme d’expression/affirmation personnelle, de créativité et de liberté dans la sphère publique, tout comme les romans qui constituaient un échappatoire, leur donnaient de « mauvaises idées », donc une menace à leur soumission et à leur « discipline »).
Lors du procès du roman, au motif du reste parfaitement stupide d’immoralité (promotion de l’adultère notamment), l’avocat (Pinard) à charge avait tout de même vu juste en décrivant ce portrait de femme: « A-t-il essayé de la montrer du côté de l’intelligence ? Jamais. Du côté du cœur ? Pas davantage. Du côté de l’esprit ? Non. »
C’est à se demander si les gens qui qualifient l’héroïne de « rêveuse romanesque » ont vraiment lu le livre ?! La réalité du personnage est beaucoup plus terne et terre à terre…
Le « problème des femmes qui lisaient des romans » (cf. le titre éloquent de Laure Adler, « Les femmes qui lisent sont dangereuses ») reflétait une vérité sociologique historique, assez fondamentale d’ailleurs dans l’histoire littéraire (puisque coïncidant avec la constitution du canon littéraire dont les femmes ont été minutieusement exclues progressivement), celle qui a été baptisée en Angleterre, la « panique morale » sur les romans qui étaient catalogués, en particulier par les moralistes, comme des instrument de perversion des femmes blâmées et stigmatisées pour leurs goûts romanesques « non conformes » les éloignant de leurs devoirs matrimoniaux domestiques de bonniche et les incitant à de rêver d’une vie meilleure (ô scandale !). Les romans sentimentaux en particulier étaient donc considérés comme un « vice » car menaçant l’ordre social patriarcal basée sur la domination masculine et la soumission des épouses, ainsi que de façon plus générale la hiérarchie socio-économique (crainte du nivellement et volonté de l’aristocratie de ne pas perdre ses privilèges). L’essor des femmes écrivains à à la fin du XVIIIe siècle, et la « féminisation » de la culture ont ainsi généré une grande anxiété masculine face à l’émancipation des femmes qu’ils tentaient donc de réprimer par tout moyen).

Détail du tableau d’André Brouillet : Une leçon clinique à la Salpêtrière, 1887)
En résumé, un homme rêveur est un idéaliste, une femme rêveuse est une abrutie de première ! Le premier induisant une idée de pureté et de grandeur et la deuxième, une faiblesse et une stupidité…
Le ton entier du roman est d’ailleurs insupportable de suffisance paternaliste, cette fameuse « ironie » suintante de mépris (dont parlait Annie Ernaux au sujet de son « écriture plate ») et de misogynie teintée de cynisme dont Flaubert ne se dépare jamais pour dépeindre son personnage.
Exemple parmi tant d’autres, un de ses commentaires sur le caractère d’Emma, parfait écho de ses préjugés sexistes personnels (cf. « [les femmes] n’ont pas un appétit désintéressé du Beau. Il faut toujours pour elles, qu’ils se rattachent à quelque chose, à un but, à une question pratique« ) : « Il fallait qu’elle pût retirer des choses une sorte de profit personnel; et elle rejetait comme inutile tout ce qui ne contribuait pas à la consommation immédiate de son coeur, étant par tempérament plus sentimentale qu’artiste, cherchant des émotions et non des paysages. »
Ce qui explique probablement l’engouement jamais démenti du lectorat masculin (on a eu même droit à un remake par Claro il y a quelques années) pour ce roman mettant pourtant en scène une femme quand on sait la réticence des hommes en général à se projeter dans un « livre de femme ».
Ici on a certes une femme mais vue par un homme et conforme en tout point aux stéréotypes sexistes en cours depuis cette bonne vieille Eve (tout aussi célèbre) dont Emma n’est finalement qu’une parente 🙂
Et comme Eve, à la fin, elle paie pour ses « pêchés », celui d’avoir trop lu donc, d’avoir désobéi à la règle masculine de rester à l’écart du savoir: ruinée, abandonnée, méprisée, mauvaise mère (conformément au préjugé qu’une femme qui lisait manquait ensuite à tous ses devoirs domestiques donc), mauvaise épouse bien sûr, et suicidée ! Pas un poncif ne manque à la liste. Sur le même thème, le portrait de l’anglaise Charlotte Lennox (« The Female Quixote ») presque un siècle plus tôt, était plus subtile -bien qu’aussi écrasé par les contraintes patriarcales- et montrait mieux comment les femmes pouvaient s’affirmer et gagner en autonomie grâce à l’imaginaire et aux héroïnes audacieuses de leurs lectures.

Adaptation de Madame Bovary en 2015 par la jeune réalisatrice Sophie Barthes : « Elle est à peine entrée dans l’âge adulte qu’elle enchaîne déjà toute une série d’erreurs d’appréciation qui vont la précipiter dans cette spirale de l’autodestruction. Il s’agit d’une jeune femme naïve et vulnérable, vivant dans un monde de projections et de fantasmes, qui va se faire dévorer par cette envie irrépressible d’accéder au plaisir »
Cela m’irrite d’autant plus que ce roman, porté au nu, trône chaque année en position frontale des programmes et des annales du bac français comme représentant ultime de la condition féminine (on se donne bonne conscience pour rétablir la parité avec ce type d’oeuvre au lieu de donner à l’étude des livres écrits par des femmes et donnant un vrai point de vue féminin pour changer ! Au hasard la princesse de Clèves -grand absent du programme en revanche !- autrement plus captivant et juste sur la position et le ressenti des femmes sans arrière-ton condescendant pesant !).
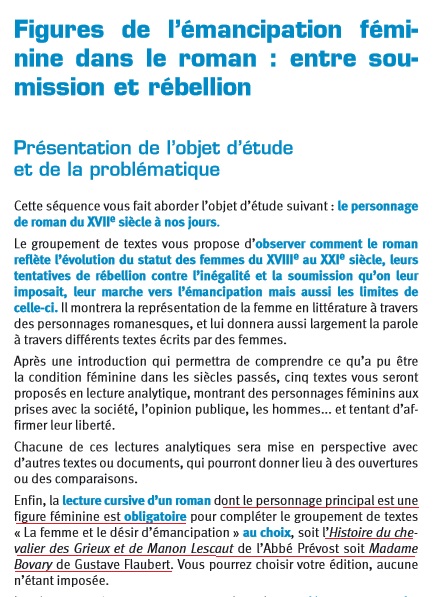
Extrait d’un programme d’étude pour le bac français axé sur la femme mais ne proposant aucune œuvre d’écrivain féminin…
Si ce livre doit vraiment être étudié, alors que l’angle misogyne soit aussi abordé et mis en avant, en écho à la correspondance de Flaubert qui ne se cache nullement de ces positions dégradantes et peu reluisantes à l’égard de la femme au lieu de cette dévalorisation concertée et complaisante de la femme à travers le personnage d’Emma et d’une vaste entreprise de ridiculisation de la sensibilité d’une jeune fille à une époque où si peu d’opportunités sont alors offertes aux femmes. Une mise en contexte et un sens critique plus pertinent s’impose au lieu de la lecture au premier degré et élogieuse en tout point, qui en est généralement faite, présentée comme la « satire d’une jeune provinciale ». Le même reproche pourra être fait lorsque sont étudiées par exemple « Les femmes savantes » ou « Les précieuses ridicules » d’un Molière, dans la même veine, par exemple où la misogynie de l’époque et les cabales des hommes contre l’éducation des femmes ne sont aussi souvent pas mentionnés ni expliqués…, et le vrai rôle littéraire avant-gardiste des précieuses totalement ignoré (cf. l’excellent essai « Les Précieuses : Naissance des femmes de lettres en France au XVIIe siècle » de Myriam Dufour-Maître)
Alors de voir fleurir aujourd’hui de nouvelles « Emma Bovary », y compris sous la plume de romancières contemporaines françaises, dans cette attitude de schizophrénie caractéristique des « infériorisés » qui tentent de s’accorder à la culture dominante (rejet/dissociation de soi, « the twoness » dont parlais le militant afro-américain Web Dubois, et dans le cas précis des femmes, ce qui a été nommé l’internalisation de la misogynie), me paraît assez regrettable et triste. N’a-t-on pas aujourd’hui autre chose à raconter que des clichés de femmes qui s’ennuient de leur propre vacuité, en particulier avec ce ton de dénigrement détestable ? Cela ne paraît guère crédible et plus des copies/imitations de représentation masculine, Bovary en tête, plutôt que de « vraies » femmes.
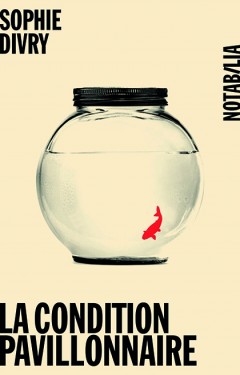 Je pense par exemple à « La condition pavillonnaire » de Sophie Divry (voir extraits choisis), se plaçant ouvertement sous la houlette bovaryenne, citations en exergue à l’appui. « Jeune romancière qui monte » elle s’est faite notamment remarquer avec cet opus lors de la rentrée littéraire de septembre 2014 (et précédemment avec les névroses d’une bibliothécaire frustrée dans La Cote 400, puis l’analyse de sa foi catholique dans « Journal d’un recommencement »).
Je pense par exemple à « La condition pavillonnaire » de Sophie Divry (voir extraits choisis), se plaçant ouvertement sous la houlette bovaryenne, citations en exergue à l’appui. « Jeune romancière qui monte » elle s’est faite notamment remarquer avec cet opus lors de la rentrée littéraire de septembre 2014 (et précédemment avec les névroses d’une bibliothécaire frustrée dans La Cote 400, puis l’analyse de sa foi catholique dans « Journal d’un recommencement »).
La somme de travail mené pour reconstituer la vie entière d’une femme née dans les années 50 dans une famille de petits commerçants modestes jusqu’à sa fin de vie en maison de retraite après une vie confortable et classique dans un pavillon de banlieue avec son mari, enfants, petits enfants et au milieu un amant qui la plantera méchamment, se sent indéniablement. La qualité d’écriture est aussi réelle, comme notamment ses reconstitutions riches des bruits du quotidien, claquement de portières, etc jusqu’à la boucle de ceinture de son amant qui forment une symphonie de sa routine se faisant écho et symbolisant ses rapports aux autres, notamment aux hommes. Une écriture organique qui n’est pas sans rappeler celle d’un Jauffret parfois (un peu écrasée toutefois par ses références toutefois, cf. ci-dessous).
Pourtant tout comme chez Flaubert, cela sonne faux. On ne croit tout simplement pas à cette femme qui ne semble être que le reflet d’un cliché éculé, celui de la femme superficielle avec un pois chiche dans la tête qui s’ennuie, même si elle n’est pas femme au foyer et qu’elle a quand même étudié, elle reste finalement une simple midinette dont le seul intérêt est de l’observer telle une bête curieuse tourner dans sa cage domestique (ou son bocal comme le suggère la couv’ du livre!) et surtout de la tourner en ridicule. Car tel Flaubert, le ton de Divry manque cruellement d’empathie et dégouline de cynisme (cf. notamment son usage abusif des guillemets par exemple).
Elle n’a jamais pris le temps de s’interroger sur les motivations profondes de son personnage mais s’est juste conformée à l’image patriarcale véhiculée par les hommes depuis les millénaires sur les femmes et s’est appliqué à la reproduire fidèlement.
C’est d’autant plus regrettable de la part d’une femme.
Le seul moment où elle semble toucher un peu plus à la vérité de cette femme est lorsqu’elle relate ses vacances de jeunesse en Espagne par exemple. On a enfin l’impression de ne plus avoir à faire à un personnage de carton pâte.
L’autre souci tient aux quelques anachronismes: Divry ayant l’âge d’être la fille de sa narratrice, elle fait quelques confusions entre sa propre génération parfois maladroitement plaquée sur celle de la première et ne parvient pas à restituer l’esprit de mai 68 notamment. La seule différence résidant essentiellement dans les évolutions technologiques.
Enfin dernier point négatif, l’influence un peu trop pesante de quelques auteurs sur sa prose qui paraît du coup « pâle copie », entre autres Houellebecq pour l’insertion d’extraits didactiques/sociologiques comme sa description
de la construction du réseau de voies automobiles en France dans les années 60 qui paraît assez laborieuse ou l’usage des points virgules, et puis bien sûr Annie Ernaux pour le thème des classes sociales, de l’ascension, et l’insertion de citations de « bribes entendues », sans son empathie.
La même année, Leïla Slimani romancière franco-marocaine, également journaliste, livrait ce que la presse a nommé « une version X de Madame Bovary » avec « Dans le jardin de l’ogre« . J’avoue ne pas avoir eu le courage de me coltiner cet opus. Même si l’exploration de la sexualité hors norme d’un personnage féminin peut-être intéressant, le personnage de la « nymphomane » semble plus relever d’un fantasme masculin que d’une réalité (l’auteur a d’ailleurs confié en interview que son inspiration première lui est venue de DSK !)…, même dans le récit de la vie sexuelle de Catherine M., elle se pose avant tout comme le jouet des désirs masculins sans jouissance personnelle. Slimani a donc suivi ce schéma, en créant un personnage accroc au sexe mais sans plaisir et sans satisfaction, dans une violence constante. « Ce qui est subversif chez elle, ce n’est pas le sexe, c’est sa passivité, sa paresse. Elle ne veut pas correspondre aux rôles qu’on lui propose. Je trouve qu’il y a quelque chose de très triste dans la sexualité. » a-t-elle d’ailleurs confié à Libération.

Leïla Slimani, auteur de « Dans le jardin de l’Ogre »
Extrait:
Elle voudrait n’être qu’un objet au milieu d’une horde, être dévorée, sucée, avalée tout entière. Qu’on lui pince les seins, qu’on lui morde le ventre. Elle veut être une poupée dans le jardin d’un ogre.
Parmi ses sources d’inspiration, on trouve bien Madame Bovary ainsi que Thérèse Desqueyroux, Anna Karénine et Belle de jour… La première et la troisième qui lui ressemble d’ailleurs dans son côté « projection des préjugés masculins », laissent donc craindre le pire… On se dit que faute de pouvoir s’inspirer d’une femme réelle, celle-ci a l’air, tout comme Flaubert, d’avoir plaqué un comportement masculin/des préjugés masculins sur un corps féminin, même si elle évite malgré tout l’écueil d’une femme « superjouissante ».
Dans le très acclamé « Les lisières » d’Olivier Adam paru à la rentrée 2012, on y échappe pas non plus avec le personnage tout aussi caricatural de « Sophie », l’amour de jeunesse du narrateur qu’il retrouve en mère au foyer bien évidemment névrosée et désespérée droguée à TF1 et aux anxiolitiques. Comble de l’horreur: elle vit dans un pavillon de banlieue parisienne près d’une forêt… De quoi devenir dépressive à tous les coups !
Il en dresse ainsi un portrait convenu auquel ne manque aucun des clichés éculés du prototype de la femme fade à la vie morne et vide:
« Elle menait la vie qu’elle avait toujours déclaré ne jamais vouloir vivre: la maison, les enfants et l’image de sa mère errant sans but dans le pavillon et les rues du centre-ville, triste et désoeuvrée, morose et bientôt prise dans les lacets d’une dépression molle que nourrissaient l’ennui, la répétition des jours et la laideur environnante. » (148)
« elle ne ferait jamais comme sa mère qui avait arrêté de travailler pour élever ses enfants et déprimait dans son pavillon la télé allumée du matin jusqu’au soir, à faire et refaire le ménage, repasser, feuilleter des revues à la con, écouter RTL, remplir des gestes mécaniques, utiles et concrets le temps qui séparait le départ pour le boulot et l’école du mari et des enfants de leurs retours, déambulant le cerveau vide dans la maison nette, sortant huit fois par jour au moindre prétexte, dans des rues connues par coeur, le maigre centre-ville, L’intermarché, la pharmacie, les allers-retours pour accompagner les gosses à l’école, à la piscine, à leurs cours de judo, tout sauf rester seule dans la maison trop silencieuse, et si nette qu’on aurait dit que personne n’y vivait, la maison si froide et silencieuse que l’on aurait dit remplie du bourdon des appareils électriques, la vibration du réfrigirateur, les émissions du matin à la télé, la table à repasser dépliée dans le salon devant Amour, Gloire et Beauté, Matin bonheur, Tournez Manège, Motus, Les Z’amours, les vieilles séries, les vieux téléfilms (…). A côté de ça n’importe quel job semblait plus enviable, même caissière ou femme de ménage, du moment qu’elle sortait de là (…). » (p. 195)
« Elle ressemblait à des centaines de milliers de femmes, pareillement vêtues, pareillement coiffées, pareillement minces, cheveux châtains mi-longs yeux marrons… »
L’auteur fait d’ailleurs lui aussi référence comme il se doit à ses modèles littéraires en qualifiant son épigone de
« Bovary de banlieue sud, Chatterley de lotissement pavillonaire »
Le clou du spectacle qui ne manquera pas de déclencher un fou rire (jaune) est lorsque le narrateur obtient triomphalement confirmation de ses préjugés en fouillant la boîte à pharmacie de sa salle de bains:
« elle menait cette vie-là qu’elle avait toujours crainte, cette vie où sa mère s’était peu à peu emmurée, réduite au silence, aux cigarettes les yeux dans le vide, aux médicaments, à l’ennui, au chagrin qui étouffe le coeur et les poumons, la télévision débile et les jours sans début ni fin, les semaines se répétant à l’infini, réduite et sans horizon. (…) Sophie se bourrait d’anxyolitiques et d’antidépresseurs comme tout le monde (…) » (p. 207)
Le narrateur nous informe alors qu’il ne peut s’empêcher de ressentir de la « pitié » pour elle.
Mais que l’on se rassure, il est là malgré pour jouer les héros sauveurs des femmes au foyer bovarysantes en détresse, en la faisant « jouir »: ‘elle se sentait enfin vivante, vivante comme elle ne l’avait plus été depuis longtemps.« (p.312) Ouf, heureusement qu’Olivier Adam, son alter ego du moins, était là!
A noter que son personnage de Sarah dans Le coeur régulier est déjà façonné peu ou prou sur le même modèle:
la femme mariée à un cadre supérieur avec deux enfants et qui étouffe dans son mariage rangé d’apparence parfaite, son pavillon de banlieue parisienne cossu et sa vie trop ordonnée, que son frère Nathan artiste torturé (un autre alter-ego d’Adam pour changer) méprise et condamne la faisant culpabiliser). Elle finira par s’enfuir au Japon après le suicide de son frère pour tenter de trouver un sens à sa vie.
Enfin, pour donner un ultime exemple récent, toujours de 2014, décidément cru bovaryen riche!, je citerai aussi « L’amour et les forêts » d’Éric Reinhardt ayant remporté comme ses deux consœurs un beau succès.
D’après Le Point, il « offre le portrait d’une madame Bovary moderne que la littérature – ainsi qu’une émission de France Inter et Meetic… – a poussée à franchir les limites de son quotidien qui va alors basculer dans le drame. » Ironie: contrairement à Divry et Slimani, bien qu’auteurs femmes, l’auteur a semble-t-il fait le choix de s’inspirer, pour changer, d’une vraie femme (ô miracle !) et non de verser dans la caricature et les clichés patriarcaux. Un effort louable qui est à saluer. Je ne l’ai pas lu non plus, je ne suis pas certaine que cela m’intéresse ne raffolant pas du style un peu précieux de l’auteur qui manque de fluidité à mon goût mais je me laisserai peut être tenter (apparemment il a pas mal utilisé les écrits de son sujet d’inspiration donc c’est peut-être plus lisible, ha ha !, voir ci-dessous)… C’est ce qui explique peut-être aussi le plus grand écho (accumulation de prix) rencontré par l’auteur (sa notoriété aidant aussi bien sûr)
Revers de la médaille, son modèle d’inspiration semble aussi être l’auteur de divers passages du roman qu’il lui aurait piqué en douce alors que celle-ci lui aurait confié son manuscrit, « La jetée », à relire ou écrit divers e-mails (ceci rappelle « Les jeunes filles » de Montherlant où l’on retrouve des copies d’extraits de lettres de Jeanne Sandélion, qui comme sa Bénédicte Ombredanne, était une admiratrice passionnée de l’écrivain. On dépasserait donc ici largement la simple inspiration d’un personnage réel (qui à mon avis n’a rien de répréhensible à partir du moment où l’identité est masquée) pour tomber franchement dans le plagiat et la violation des droits d’auteur: utiliser la prose d’autrui sans son accord. Voir l’article de l’Express de mars 2015 au sujet de cette mise en cause de Reinhardt.
Ainsi l’archétype de « la-femme-mariée-qui-s’ennuie » ou « femme-déçue-par-son-mariage » (voir en 2006, par exemple la sortie de « La mariée mise à nu » de Nikki Gemmell, ou encore « Arlington Park » de l’anglaise Rachel Cusk dans la lignée d’une Mrs Dalloway de Virginia Woolf qui pour le coup parvient à s’extraire de tous les clichés sur les femmes et à réussir magistralement à traiter le sujet sans condescendance et avec une justesse et une subtilité inégalées, Flaubert peut aller se rhabiller !) est une matière/filon romanesque qui semble apparemment inépuisable et continue d’avoir de beaux jours devant lui jusqu’à l’écœurement ? [Alexandra Galakof]













1 ping
[…] le problème avec la Bovary et ses descendantes […]