Les romanciers en particulier français (de littérature générale), mais également anglo-saxons, n’ont encore que peu exploité les thèmes de la nouvelle économie et révolution des nouvelles technologies dite numérique ou digitale selon le terme américain. Du moins sous un angle socio-économique, les répercussions plus intimes ont en revanche été intégrées assez rapidement notamment la modification des rapports sentimentaux ou de communication en général avec l’avènement du téléphone portable, des messageries électroniques ou chat ou encore réseaux sociaux, de Camille Laurens à Nicolas Fargues ou plus récemment je pense à Clémentine Beauvais dans Songe à la douceur qui joue avec les codes du chat MSN ou de Word et de l’évolution technologique dans sa romance en vers située entre les années 90 et 2000).
C’est surtout la science-fiction qui s’est pour l’instant emparée du sujet mais sous une forme imaginaire, futuriste ou dystopique (Neuromancer de Gibson -1984- faisant figure d’œuvre culte de référence sur la culture steampunk, cité d ailleurs par Bellanger) sans tenter de retracer vraiment une réalité sociale contemporaine et ses conséquences concrètes historiques sur une époque, ce qui manque donc encore relativement dans le paysage littéraire.
Pourtant ce tournant historique est un gisement romanesque riche bien que difficile aussi à aborder pour un non initié par sa technicité. Je pense immédiatement à Zola (plus qu’à Balzac dont Bellanger se réclame pour le « récit d’ascension sociale d’un homme« ) qui s’était donné pour mission de témoigner des grands bouleversements economico-politico-industriels de son époque, la seconde moitié du XIXe siècle. Qu’aurait-il fait de l’avènement d’Internet et de l’ère des startups ?
Le défi est ici de transformer cette matière pouvant de prime abord sembler rébarbative en histoire narrative captivante avec des personnages capables de lui donner corps et vie et éviter l’ écueil de la dissertation technico-factuelle. Le roman ne doit pas s’effacer ou être relégué au second plan des faits purement historiques qui doivent rester la toile de fond, condition délicate qui s’applique à tout livre fortement ancré dans un contexte spécifique au risque de devenir un essai (écueil beaucoup reproché à Bellanger pour partie justifié, ce qui n’empêche pas son intérêt).
Côté américain, je pense notamment au livre, The social Network (La revanche d’un solitaire en VF) retraçant la genèse de Facebook a travers le parcours de Zuckerberg ayant inspiré le film, plus connu d’ailleurs que le livre me semble-t-il. Sans qualité ou style littéraire, ce dernier tient plus du docufiction (il n’est reste pas moins bien ficelé). Avant lui, Douglas Coupland avait fait figure de précurseur en choisissant dés 1995 comme héros des codeurs au service de (et asservis par) Microsoft : Microserf, mettant en lumière la culture geek et la nouvelle génération d’entreprises technologiques qui allait suivre, née selon le mythe dans le garage de leur fondateur.
Récemment un petit tour d’horizon me fait remarquer la publication de Uncanny Valley d’Anna Wiener en 2020 (L’étrange vallée en FR) retraçant son expérience professionnelle au sein de différentes start-up de la Silicon Valley au début des années 2010 et sa plongée dans la culture particulière des ingénieurs tant d’un point de vu sociologique que personnel ainsi que les dérives éthiques du milieu de la tech, entre désillusion et fascination. Côté essai, j’avais bien aimé le récit d’entrepreneuse web Girlboss de Sophia Amoruso et la série netflix qui l’avait adapté malheureusement arrêté après 1 saison où l’on découvre les coulisses et embûches du lancement d’un site e-commerce issue d’e-bay par une jeune femme, point de vue encore trop minoritaire et passionnant. Côté français, Rachel Vanier ancienne de chez Free justement publiait Écosystème relatant l’expérience de deux jeunes français tentant le rêve de la Silicon Valley. Avant elle, Antoine Bello signait Ada en 2016, un peu différant explorant les rapports entre intelligence artificielle et création littéraire sur fond de Silicon Valley (non sans rappeler sur le thème Exemplaire de démonstration de Philippe Vasset en 2003). Enfin Reinhardt publiait à la rentrée de septembre 2020 « Comédies françaises » dans lequel il explorait notamment les travaux de l’ingénieur informatique Louis Pouzin ayant conçu le système de transmission de données électroniques, le datagramme qui aurait pu faire de la France la pionnière d’Internet, sans le sabotage de l’industriel Ambroise Roux, omnipotent patron de la CGE (Compagnie Générale d’Electricité).

Bâtir un monde immatériel
Avec La Théorie de l’information paru à grand bruit critique lors de la rentrée littéraire de septembre 2012, Aurélien Bellanger est un précurseur en France et à ma connaissance pas égalé depuis sur le sujet. Même outre Atlantique je ne vois pas de roman qui aurait brassé aussi largement l’histoire (de l’avènement) d’Internet (en terme de réseau et de concept) et ses répercussions sociologiques et même métaphysico-religieuses (dites-moi si je passe à côté de qqc ?!).
La figure de Xavier Niel, fondateur de l’opérateur télécom français Free, qu’il a choisi comme emblème des nouvelles technologies françaises n’est finalement qu’un prétexte pour retracer trois décennies d’histoire télématique et cybernétique, avec au fondement de celle-ci notre fierté nationale des années 80-99 : le minitel (sur lequel l’accent est tout particulièrement mis en profondeur). Le panorama, ambitieux et large, ne peut bien sûr pas englober toutes les étapes et développements. Bellanger choisit plutôt de nous raconter l’histoire des « tuyaux » comme il était de coutume alors de les appeler, c’est à dire les réseaux de communication plutôt que les terminaux, comme par exemple l’ascension du PC ou même des applications web, de la guerre des moteurs de recherche, des navigateurs ou des messageries web ou des premiers services peer to peer comme Napster, l’émergence du e-commerce, dont il n’est pas question. Google et Facebook surtout (qu’il qualifie « d’abstraction mathématique stricte de l’univers relationnel humain« ) sont cités (le dernier donnant lieu d’ailleurs à une fin abracadantesques à base d’abeilles encodées avec les profils du réseau peu probante…) Il ne s’agit pas d’une histoire exhaustive du web à proprement parler qui de toute façon serait difficile (et probablement pas pertinente) à couvrir dans un seul livre, mais plutôt de l’évolution d’une conception du monde, de la transition du monde physique au numérique, « du passage de l’élément physique à l’élément logique. » Il définit d’ailleurs l’informatique comme « une science légère, qui prétendait manipuler de l’information plutôt que de la matière… » (p.175). C’est la même idée qu’il fait développer dans la bouche de Thierry Breton au Futuroscope (que ce dernier a réellement participé à lancer) : « Demain, tous les atomes de l’univers seront quantité négligeable : on les aura tous modélisés et stockés dans des cartes mémoire. C’est cela, l’économie de la connaissance, l’économie du numérique (…). Le monde matériel a perdu la partie » ou encore le nouveau « monument immatériel » que l’humanité s’était attelé à bâtir (p. 201). C’est aussi la transition des empires pétroliers basés sur les énergies telluriques et fossiles vers les empires de l’information (même si l’analogie ne semble pas vraiment appropriée en comparant deux éléments non relatés… , et alors que l’informatique n’a pas affranchi l’humanité de ses besoins en énergie et repose toujours sur une partie matérielle « hardware »).
L’accent est donc au final beaucoup plus sur le contexte et l’évolution des technologies -et surtout leurs implications à plus grande échelle sur le plan humain et métaphysique- que sur son personnage principal Pascal Ertanger inspiré de Niel donc mais dont l épaisseur psychologique reste trop fine pour inspirer la moindre émotion ou même réaction. Il ne reste qu’un figurant écrasé par l’Histoire avec un grand H qui est le vrai sujet du livre, ce qui rend donc délicate l’appellation « roman » du livre qui penche plus du côté du docufiction et du roman à thèse voire de l’essai. Fait (ou défaut ?) qu’on lui a abondamment reproché lors de sa publication, en particulier d être une compilation d’articles Wikipedia, ce que le récit, doté d’une vraie structure narrative et d’une écriture ambitieuses et sophistiquées, n’est absolument pas. Bellanger s’en défendait d’ailleurs très bien dans un entretien à Nonfiction.fr (oct. 2012) : « Mon rôle en tant que romancier, c’est seulement d’inventer un parcours singulier à travers cette montagne d’information.«
Il invente ainsi une poétique des machines – ordinateurs, serveurs, datacenters- comme lorsqu’il décrit leurs « diodes allumées qui formaient la nuit des yeux de chat dans les bureaux éteints. » Même s’il est vrai, comme l’a reconnu l’auteur, qu’il puise largement dans l’encyclopédie en ligne pour nourrir ses nombreuses pages entrelaçant histoire technique, politique et sociale, il n’en reste pas moins qu’un lourd travail de restructuration et de mise en narration de toute cette riche matière didactique a été mené pour lui donner un sens éclairant la destinée humaine. Il tente ainsi de relever le défi de cette fameuse impossible « synthèse » des sciences et des savoirs pour atteindre le sens ultime dont parlait Houellebecq en citant Lovecraft dans L’appel de Cthulhu (« l’incapacité de l’esprit humain à mettre en corrélation tout ce que renferme [le ciel] », « la synthèse de ces connaissances dissociées nous ouvrira des perspectives terrifiantes sur la réalité ») et qu’il cite dans son essai « Houellebecq, écrivain romantique » publié en 2010 (p.24) même si Houellebecq dans Interventions pense que l’humain a « vocation à une connaissance totale » (cité encore par Bellanger dans son essai , p.63).
Positivisme, Leibniz & Religion : l’antichambre de La théorie de l’information
Cet essai qui a précédé l’écriture de La théorie de la communication est tout particulièrement intéressant à lire en parallèle pour éclairer davantage le projet narratif de l’auteur et sa genèse qui clairement touche à percer ou au moins accéder au mystère de l’univers et au sens de la vie, cette question métaphysique millénaire des philosophes qu’il rappelle : pourquoi quelque chose plutôt que rien ? A laquelle il ajoute : « quel rapport Dieu entretient-il à sa création ?«
Ses analyses de la philosophie et des influences (notamment le positivisme d’Auguste Comte), sous-tendant Les particules élémentaires ou La possibilité d’une île, fournissent en particulier les sources de son inspiration directe et donnent à voir l’antichambre de l’écriture de La théorie de l’information : comment ses différentes idées sur la science et la littérature se sont formées et construites. Ce chantier s’avère ainsi assez passionnant à reconstruire. Il déclare par exemple admiratif que Houellebecq a fait « entrer la science dans une œuvre littéraire » (manifestement une ambition qu’il partage et pour laquelle il a été salué). Il identifie le positivisme comme sa doctrine majeure consistant à « rapporter l’histoire des sciences à un projet de moralisation du monde » et « d’imposer aux sciences naturelles une moralité indestructible ».
Le principal intérêt du positivisme est notamment de « produire des lois permettant de modéliser les phénomènes et de prédire le résultat des expériences… » (p.54). C’est ainsi qu’en parvenant « à une description exhaustive et opérationnelle du monde (…) la nature humaine devient tout au plus un ensemble de prédictions » (p.55).
Son observation sur la religion produite par le positivisme nous amène au cœur de la thèse de La théorie de l’information lorsqu’il affirme que « la religion comtienne est une thermodynamique » puis relie « cet aspect thermodynamique de la religion » à un extrait des particules élémentaires (p.57). La religion agissant comme un « radiateur » de l’humanité qui ne saurait subsister longtemps sans religion quelconque, grâce à son « mécanisme de contrôle, et instrument de calcul. »
Il aboutit ainsi à une définition rationnelle de la religion : « la religion doit respecter tous les canons du plus strict rationalisme et ne proposer aux hommes que de maximiser leurs calculs rationnels pour accomplir a posteriori le choix du meilleur des mondes possibles que le Dieu de Leibniz faisait a priori, au premier jour du monde » (p. 58).
Comte considérait que « le progrès était le développement de l’ordre » (p.59).
Cette nouvelle religion se constituant sur la base des avancées techniques et des résultats bénéfiques probables de la recherche scientifique (p.202) donne naissance à un messianisme technique. Celui-ci « vise à établir un contrôle technologique absolu de l’homme sur la nature, y compris sur sa nature biologique, et son évolution. Cela dans le but à long terme de reconstruire une nouvelle nature sur des bases conformes à la loi morale, c’est-à-dire d’établir le règne de l’amour… » selon Houellebecq dans son apologie de la penseuse féministe américaine Valerie Solanas, toujours cité par Bellanger dans son essai.
Bellanger conclut en interprétant ses propos que : « L’humanité et le monde sont améliorables. Même Dieu à la limite pourra être programmé. » Il relève qu’il s’agit là d’un thème classique de la science-fiction « particulièrement bien traité par Norman Spinrad dans Deus ex, revendiqué par Bruce Sterling, hyperexploité par Dantec. » (ce dernier entretenant une certaine filiation avec Bellanger aussi pour la profusion encyclopédique).
La note de bas de page fournie de la p.203 peut se lire comme une note d’intention littéraire de son premier roman alors qu’il constate qu’ « une histoire informationnelle de la théologie reste à écrire, une histoire de la théologie comme branche particulière des sciences de l’information… »
Il cite ici également déjà Leibniz qui rapportait la création du monde a un calcul binaire primitif opéré dans l’intellect : « omnibus, ex nihil ducendis, suffit unum » (un suffit à tout extraire du néant) ou encore comment des physiciens contemporains adoptent le slogan « it from bit » et entendent réduire le monde à de la seule information.
Discerner, derrière le bruit désordonné des choses, des structures invariantes. (p.310)
Plus précisément il cherche à explorer les liens entre programmation informatique et création ou du moins « structure profonde » de l’univers (avec en arrière plan l’idée d’un démiurge). En d’autres termes, il s’agit de la tentative de l’homme de modéliser l’univers et d’atteindre à son algorithme, sa grande équation ultime, pour enfin révéler son secret et le maîtriser. Même si comme il l’admet ce dernier échappe à cette tentative « naïve » de résoudre son « chaos » en découvrant l’ordre, la logique derrière son « bruit », par son caractère imprévisible et brutal « sautant d’une configuration à l’autre » (p. 429) .
Les thèmes des conférences que donne Pascal Ertanger avec son ami d’enfance Xavier Mycenne reflète ces pistes de réflexions sous-jaçentes au projet littéraire de Bellanger par une mise en abyme narrative :
L’univers est il une simulation ?
La théorie de l’information est-elle une nouvelle théorie du tout ? L’informatique détient-elle les clés du mouvement perpétuel ?
Peut-on programmer Dieu ?

La technologie comme nouvelle religion
Dans la lignée du positivisme comtien évoqué ci-dessus, la thèse de l’auteur porte notamment sur la technologie ayant supplanté et pris le relais de la religion. Les technophiles font ainsi office de nouveaux croyants ou de convertis. Dans plusieurs interviews, il revient sur cette intention se profilant derrière son roman qui “(…) acte le fait que l’information est ce qu’il y a de plus proche aujourd’hui d’une religion. Je voulais créer un personnage qui soit comme le premier croyant de ce monde.” ou encore il explique avoir voulu « décrire le prototype d’un nouveau type de croyant qui croyait à l’avènement des machines, à l’information comme théorie religieuse » (Nonfiction.fr, 2012).
Comme il le souligne toutefois de façon intéressante, il faut se rappeler que la religion entretient historiquement des liens avec la science, plus particulièrement observables au cours du siècle des Lumières mais déjà présent depuis la 2e moitié du XVIIe siècle depuis les découvertes de Newton, avec la figure d’un Dieu comme grand « horloger » de la mécanique de l’univers. On parlait alors de « religion naturaliste » ou « rationaliste » (basée sur l’observation de la nature, l’empirisme, la raison de façon plus globale avec un Dieu l’incarnant de façon suprême) par opposition à celle uniquement basée sur la foi et les écritures saintes (la « révélation »). Enfin au delà de ces évolutions et débats dans les approches religieuses au fil du temps, la religion demeure de toute façon la première « discipline » ou savoir par laquelle l’humain a cherché à comprendre et expliquer le monde qui l’entourait, jusqu’à ce que la religion entre en conflit avec les sciences dures physiques et mathématiques et tente de se réconcilier avec a travers la religion naturelle comme explicité ci-dessus.
Bellanger nous apprend aussi que le mot ordinateur version francisée de « computer » a lui même une connotation religieuse par sa référence au grand ordonnateur divin ; l’ordination étant une cérémonie religieuse et l’adjectif désignant Dieu qui met de l’ordre dans le monde (selon une citation de Jacques Perret professeur de philologie latine dans une lettre du 16 juin 1955, page 67). Information véridique après vérification !
En ce sens le livre comporte une dimension philosophique importante, liée au bagage universitaire de Bellanger même si elle reste à un niveau superficiel bien évidemment de par le genre romanesque choisi. Bellanger étant assez rétif à la discipline et rigueur qu’imposent l’exercice d’une vraie thèse ce qui l’a découragé de poursuivre dans cette voie, son roman penche toutefois du côté de cette dernière par sa forme hybride tout en s’affranchissant de toutes ses contraintes intellectuelles à commencer par le sourcing et la bibliographie (hormis la source vague revendiquée de Wikipédia, qui est d’ailleurs interdit dans les bibliographies des travaux universitaires :-)). Cette lacune s’avère gênante et frustrante car on se demande sans cesse ce qui est vrai ou relève de la fiction concernant les faits économiques en particulier. Si cela ne gêne pas pour une histoire intime d’inspiration autobiographique, cela le devient quand on touche à l’Histoire générale). Un minimum d’annexe/appendice manque cruellement ici…
Dans une interview donnée à Nonfiction (03/10/2012), Bellanger est explicite en ce sens : « J’ai une formation universitaire un peu incomplète et ce travail sur les sources n’est pas forcément évident ; Wikipédia m’a permis de le tordre un peu selon mon caprice : quand j’avais besoin de renseignements sur un sujet, je savais que je les y trouverais. »
Ainsi que dans Libération (2012) : « Au début, j’avais des ambitions théoriques disproportionnées pour la littérature. Plus le temps passe, plus je me rends compte que le roman est une enclave qu’il faut à tout prix protéger car elle permet de tout dire, c’est un lieu où le vraisemblable supplante le véridique. Il m’arrive même de me perdre moi-même dans mes degrés d’ironie. Et puis, dans un roman, on peut suspendre son jugement et tester des choses sans trop savoir ce qu’on en pense. C’est, par exemple, ce que je fais avec le transhumanisme. C’est hyper sceptique, en fait, un roman. »
Il finit par s’en défendre et même le tourner en qualité par une pirouette : « Le vrai génie, c’est de réussir à créer le trouble entre vérité et fausseté. » (itw France Culture)
Une énigme métaphysique à découvrir sur fond de science et littérature
De par son ancrage scientifico-technique délibéré, le roman s’avère une lecture parfois aride. Il faut parfois s’armer de patience pour que ses pages acceptent de nous dévoiler le secret qu’il renferme, en prenant le temps de bien le suivre dans tous ses méandres et sinuosités.
C’est ainsi en tout cas que j’ai compris et abordé le livre. Comme une sorte d’énigme à déchiffrer dont les pièces du puzzle nous sont dévoilées par fragment a travers notamment ses intermèdes d’exposés techniques (sur la thermodynamique, l’entropie et surtout le mouvement brownien qui sert de fil rouge au récit). Au départ elles semblent intrusives voire hors sujet mais peu à peu s’agrègent, se relient pour former un tout, faire sens et délivrer leur message ultime. Il faut donc s’accrocher pour les lire malgré leur contenu parfois franchement répulsif sauf à être amateur de ce type d’explication complexe de spécialiste !
A noter que l’entrée en matière décrivant Vélizy en banlieue parisienne et son développement économique lié à l’implantation de grands noms de l’industrie aéronautique, électronique ou automobile au cours de la 1e moitié du XXe siècle, ainsi que les trajectoires des parents du héros Pascal Ertanger sont assez fastidieuses et nécessitent notamment un effort pour les dépasser et atteindre le cœur du sujet. Ces pages auraient probablement gagné à être élaguées en revanche.
Un héros sans visage et sans qualités…
Le principal écueil du roman qui a été souvent pointé par la critique est l’absence d’épaisseur de ses personnages réduits à de pâles figurants. Ils semblent ne servir que de prétextes à dérouler et présenter le véritable héros de l’histoire à savoir l’Histoire d'(une partie de) l’informatique et surtout plus intéressant ses implications et enjeux humains, existentiels voire métaphysiques comme dit ci-dessus.
Le personnage central notamment, Pascal Ertanger, reste particulièrement creux (ce qui est paradoxal avec l’ambition revendiquée de l’auteur qui confiait pourtant que « son fil narratif (…) était avant tout de décrire [son] âme » (Nonfiction.fr, oct. 12) Outre sa vie personnelle sentimentale avec une danseuse de sex shop parfaitement inintéressante et non crédible, il manque surtout à comprendre ses motivations, ce qui le pousse vers son entreprise, ses conquêtes et surtout cet amassement de fortune sans fin. On est déçus de ne pas trouver un vrai portrait de l’un de ces nouveaux capitaines d’industrie 2.0 (« netocrates »), « baron du web » comme l’ont été les précurseurs de la révolution industrielle aux US (comme Andrew Carnegie) qui après avoir pareillement accumulé les millions se transforment en philanthropes pour se faire pardonner leurs péchés et gagner le paradis malgré tout. On aurait aimé mieux comprendre comment cet enfant, adolescent effacé, plus ou moins asocial, maladif passionné de sciences qui découvre avec enthousiasme les premiers ordinateurs ZX81 et la programmation en basic créée en 1964, langue primitive de l’informatique grand public, est devenu un entrepreneur sans foi ni loi prêt à tout pour s’enrichir ? L’innovation technologique est en effet peu présente, si ce n’est les magouilles pour pirater les trafics des autres serveurs de messagerie rose par exemple… Un génie des affaires qui finit par évoluer vers des intérêts plus mystiques et métaphysiques, sans que cette transition ne soit forcément très claire… Il relate ainsi p.416 : « Il ne cherchait plus à s’enrichir mais à se fixer un but précis pour unifier ses forces. Ce pouvait être un but religieux. »
Cette dernière donne d’ailleurs lieu a des pages de méditation métaphysique empruntes d’une poésie certaine (« La terre disparaissait alors derrière le brouillard acide des données échangées…« ) sur les expérimentations scientifiques d’Ertanger (hologramme de la terre) dans son musée de l’informatique final (que Bellanger imagine être à la Bourse de Paris qui a bien servi un temps de pépinière pour start ups).
L’aspect commercial semble de façon générale plus intéresser le personnage que la recherche et le développement technologique même s’il se montre fort ingénieux dans ce domaine également notamment dans sa lutte contre France Telecom pour faire tomber son monopole et accéder à la boucle locale.
Bellanger nous décrit ses actes mais de façon purement factuelle et en ce sens il respecte bien la règle narrative du « montrer sans dire » mais ses pensées intérieures, ses sentiments restent inconnus et indécelable, ce qui donne un caractère plat, une sorte de machine à lancer des entreprises et des produits, à faire des « coups » commerciaux comme celui de l’annuaire inversé, « s’endormant dans une féérie de visions stratégiques, » ou « rêvant de contrats de sous-traitance télématique, » d’abord dans le secteur du minitel rose puis dans les services télématiques des jeux, voyance, astrologie (qu’il analyse sarcastiquement comme « témoignant de la déchristianisation réussie de la société française« ), etc pour aboutir aux réseaux Internet, aux « tuyaux » donc et l’abandon de tout contenu comme il l’avait fait avec le minitel.
Bellanger livre à cette occasion diverses réflexions sur le profil d’homme d’affaires « sorti de nulle part » qu’est son personnage Ertanger, dans lequel on reconnaît bien ici les traits de Xavier Niel: « Il symbolisait à la perfection la libre entreprise, et ses valeurs simples, conquérantes et révolutionnaires. » Jean Marie Messier, fameux patron de Vivendi dans les années 90, victime de ses ambitions démesurées ou du moins mal maîtrisées, est aussi évoqué et analysé. Bellanger assimile néanmoins ces nouveaux riches de la nouvelle économie à des héritiers d’une lignée masculine de conquérants communément regardés comme prestigieux: « les Alexandre, les César et les Napoléon de l’économie numérique. »
Epopée économique
Il n’en reste pas moins que malgré cette absence psychologique, on se régale de revivre cette aventure technico-économique des années minitel qui n’avait à ma connaissance jamais été racontée de la sorte, comme si de l’intérieur (même si Bellanger n’en est qu’un rapporteur extérieur, sa recherche sur le sujet qui pour avoir vérifié certains faits semble relativement fidèle à ce qui s’est passé). Ayant personnellement connu l’ère du minitel à l’adolescence, j’avoue que cela m’a rappelé quelques souvenirs lointains et notamment l’envahissement des rues par les affiches salaces de la publicité pour les 3615 code Ulla et autres avatars que refait vivre l’auteur. Bellanger se risque à quelques analyse sociologiques aux accents Houellebecquiens sur le phénomène comme : « Le Minitel rose, avec la consommation massive d’antidépresseurs, d’anxiolytiques et de somnifères – consommation dont la France détenait le record mondial-, signalait l’apparition d’une nouvelle classe sociale, dépressive et célibataire, mais résolue à améliorer son sort. Ces prolétaires de l’amour étaient capables de dépenser 6000 francs par mois, l’équivalent d’un salaire moyen, pour planifier des rdvs sexuels qui n’aboutissaient presque jamais ou, plus simplement pour se mast##rber devant les caractères blancs, un peu flous et et presque liquides de leurs écrans. »
Les passages où il décrit les stratégies d’Ertanger qui se transforme virtuellement en bimbo érotomane partante pour tous les fantasmes pour détourner le traffic de ses concurrents sont particulièrement réussis et comiques.
Ce dont je ne me souvenais plus et que Bellanger rappelle opportunément c’est le scandale que ces nouveaux services et les « tabulistes » avait généré allant jusqu’à déclencher des discours politiques alarmistes (cf Charles Pasqua) et moralisant sur la dépravation de la jeunesse, anticipant les problèmes démultipliés par l’accès à la pornographie illimitée qu’Internet procurera et avec laquelle le minitel paraissait bien chaste (Bellanger livre d’ailleurs d’excellentes pages sur cet érotisme électronique des premières heures basé sur l’imaginaire qu’offrait les dialogues souvent alimentés par des hôtesses payées à cette fin, voir des hommes se faisant passer pour des femmes, stratagème toujours d’actualité…). D’autres anecdotes sont rapportées (que j’ai toutes vérifiées comme étant véridiques) : le lancement des Jardins du Minitel ou encore une chanson à sa gloire ! Il vulgarise aussi les raisons pour lesquelles le minitel a trépassé notamment pour son manque d’interopérabilité ou encore le scepticisme initial français sur le web dont il ne soupçonnait pas les moyens de monétisation, puis la guerre des opérateurs internet et notamment contre le monopole de France Telecom. Intérêt donc historique porté par une langue narrative vivante.
Dans ses interviews, Bellanger indique avoir voulu raconter l’histoire d’Internet en tentant de lui donner une origine française dont le minitel constitue probablement une initiative pionnière. Il décrypte d’ailleurs habilement pour le non initié les différences technologiques entre les deux et les limitations du premier ainsi que les circonstances de naissance de la toile, d’abord cantonné aux échanges entre experts informatiques.
Toutefois il souligne aussi le fait que notre Ertanger national ne reste qu’un second couteau, une figure purement locale ne bénéficiant pas de l’aura et influence d’un Steve Jobs ou d’un Bill Gates. Il dévoile ainsi cette ambition déçue de son personnage p.419: « Il aurait aimé faire à la manière de Steve Jobs des mythiques keynotes, une annonce susceptible de révolutionner le monde. »
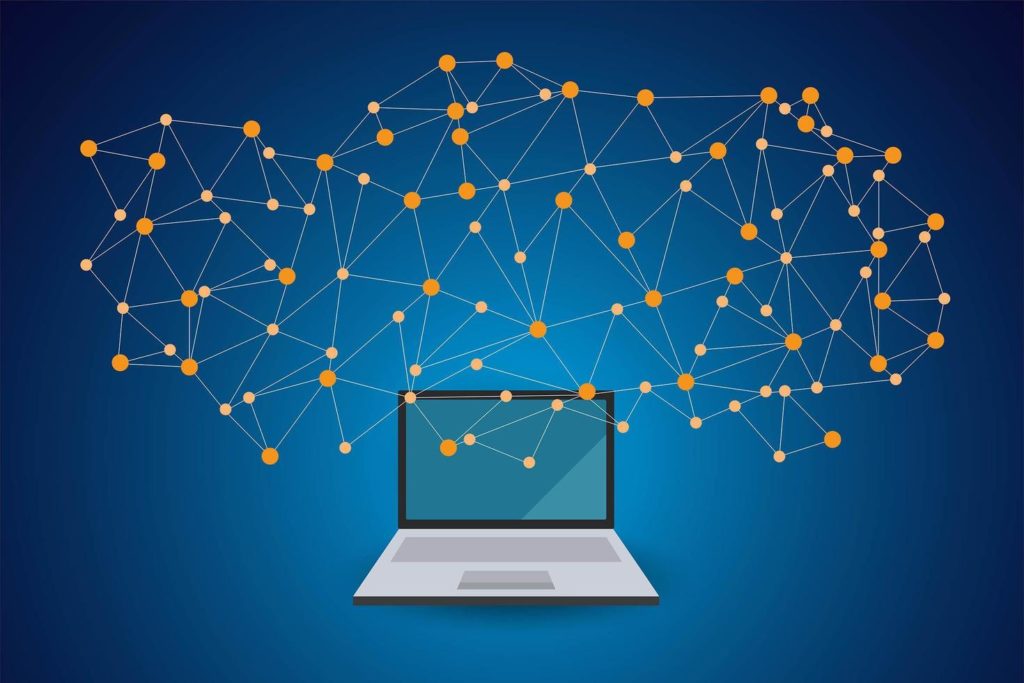
Plongée en culture geek
Il livre au passage en revanche un regard intéressant sur la communauté et la culture dite « geek » qui se sont développées en France dans les années 80 sous influence américaine :
« Largement déconsidérés, malgré leur expertise dans l’un des domaines les plus complexes qui soit, ils rêvaient en secret d’une revanche. Ils étaient les premiers chamans des âges préhistoriques, chassés de la tribu, mais titulaires de pouvoirs inconnus, les premiers chrétiens réfugiés dans les catacombes mais prêts à conquérir l’empire, les derniers moines copistes, harcelés par les guerres et les épidémies, mais sauvant les chefs d’œuvre oubliés de la philosophie antique. »
Il dépeint notamment leur passion pour les jeux de rôle (avec le mythique pionnier Donjons et Dragons de la société Transecom à partir de 1983) puis les jeux vidéo :
« Ils se retrouvaient à cinq, six ou dix dans des chambres surchauffées où, privés de la lumière du jour, ils ressuscitaient avec des dés et des cartes les âges héroïques de l’humanité. »
Il souligne à juste titre le décalage existant entre cet univers médiéval archaïque dépourvu de toute révolution industrielle, sans réel but au jeu autre que les combats et alliances. On est curieux de découvrir cette psychologie du geek qui reste encore un OVNI mal connu et mal compris même s’ils sortent désormais un peu plus au grand jour dans la culture grand public avec des séries comme The Big Bang Theory.
Bellanger note et analyse encore à leur sujet :
« les adolescents qui jouaient à Donjons et Dragons étaient bien les mêmes que ceux qui passaient des nuits blanches à programmer. C’était les deux faces d’un même mode de vie. On retrouvait, bien sûr, dans l’informatique et les jeux de rôle, la même obsession procédurière. Mais malgré quelques tentatives réussies de synthèse, comme la trilogie Star Wars, le monde humide et verdoyant des récits fantastiques restait en opposition complète avec l’univers de science-fiction des ordinateurs. Il fallut attendre l’arrivée des grands jeux de rôle sur PC et consoles au milieu des années 80 -Zelda, Dragon Quest et Final Fantasy- pour que les deux univers fusionnent explicitement… »
Il cherche à éclairer cet engouement des geeks pour ce type de jeux (qui peut se lire comme une mise en abyme de sa propre entreprise littéraire d’ailleurs, pour le côté résolution d’énigme que j’évoquais ci-dessus) : « Le succès des jeux de rôle chez les geeks du monde entier trouve sans doute son explication profonde dans leur rapport passionné à la science, qu’ils aimèrent d’abord pour son vaste réservoir d’énigmes a résoudre avant de découvrir que l’univers lui-même était un jeu régi par un moteur physique, et comme tel sujet aux évolutions techniques entre ses différentes versions. Le fantastique n’était en ce sens pas quelque chose d’entièrement exotique. Pascal, comme la plupart de ses compagnons de jeu, connaissait le 3e commandement d’Arthur C. Clarke : « toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie » (p.73-74).
On pourra aussi probablement rajouter à son explication le goût plus général de la domination masculine (et la quête d’adrénaline associée) qui se retrouve aussi dans ces jeux faits de combats et d’alliances pour la prise de pouvoir et en grandeur nature par les empires et/ou monopoles bâtis par les plus offensifs d’entre eux qui sous leurs aspects introvertis se sont avérés des conquérants de marchés redoutables…
Son analyse de la communauté des amateurs d’ovnis (p.160) pourrait encore s’appliquer à ces derniers lorsqu’il les décrit comme « attendant de la science un ensemble de sensations fortes ou d’énigmes captivantes, comme celles que proposaient la relativité générale et la physique quantique » ou aimant « l’idée que les énigmes de la vie et de la science convergent…« , cette dernière caractéristique semblant faire directement aussi écho au projet littéraire que s’est fixé Bellanger.
Il analyse aussi avec justesse la mécanique et les effets psychologiques des jeux vidéos avec une image cérébrale assez saisissante : « quiconque connaît le monde des jeux sait que tout est faux, illusoire et lointain , à l’exception de la matière terne et repliée du cerveau.«
« L’homme est une machine qui explore à l’aveugle les circuits compliqués de son propre cerveau, un labyrinthe de plaisirs et de peines, de récompenses et d’obstacles. En jouant l’homme rabat sa vie sur le cybernétique implacable (…) Jouer c’est plonger son corps dans un acide qui en dissout couche après couche, tous les tissus et membranes, toute la nature organique et sensible, jusqu’à ce que le cerveau soit mis à nu comme machine électrique autonome et comme réseau logique terminal.«
Il nous entraîne aussi dans les concerts punk underground donnés dans les catacombes de Paris fréquentés notamment par la faune des classes de math sup et d’écoles d’ingénieur.
Il dresse enfin des parallèles avec les films majeurs de l’époque abordant ces nouvelles thématiques du piratage informatique à la prise de pouvoir des robots/machines, tel que Wargames (1983) sur les premiers hackers fascinant les lycéens d’alors, replaçant l’histoire de l’informatique dans la pop culture, ce qui l’enrichit de perspectives assez passionnantes.
La guerre contre les machines
Dérivant sur la crainte classique masculine de la prise de pouvoir (on en revient toujours à elle !) des machines pour asservir les hommes, il s’appuie ici sur le film Terminator ou (p. 393-95 ) dans le cadre d’un pseudo article de recherche écrit par le meilleur ami d’Ertanger, Xavier Mycenne. Il estime notamment que les machines sont redoutables car dépourvues d’affects : « La guerre qui oppose les hommes et les machines est la plus effrayante de toutes. Elle vise à la destruction des propriétés intentionnelles.
L’homme désire toujours quelque chose et se forme des représentations du monde. Les machines ne veulent rien et ignorent l’existence du monde. Du point de vue des machines, l’idée même de victoire n’a aucune signification. Livré à la paix perpétuelle du chaos atomique, l’univers sera redevenu éternellement neutre. »
La réflexion peut surprendre car comme je le soulignais dans un précédent article (« De la domination des machines« ) datant de 2011, l’absence d’émotions ou de désirs me paraît justement rendre impossible le retournement des machines contre les hommes !
En réalité, Bellanger vise plutôt la dépendance des hommes aux machines qui pour le coup s’avère beaucoup plus pertinente (l’homme s’auto-asservissant) :
« La singularité technologique est décrite comme le point de non-retour du progrès technique, quand il cesse d’être conduit par les hommes pour être conduit par les machines. »
A partir de là, il développe sur le concept de la « singularité technique » qui marque « l’avènement du temps des machines. » Il s’appuie sur les idées du
singulariste Nick Bostrom qui imagine un « calculateur assez puissant pour opérer des simulations complètes et détaillées de tous les univers concevables. » Cela reviendrait donc à ne plus distinguer la simulation de la réalité. Il en conclut que « dès lors la question de l’origine du monde est statistiquement résolue : il existe un seul monde dont l’origine reste inexplicable pour une infinité d’autres qui sont des simulations menées au sein d’une singularité technologique. » Le point bancal de cette hypothèse relève t-il est toutefois qu’il semble « étrange qu’une machine éprouve le besoin de mener des simulations ou de conduire des expériences. »
C’est plus particulièrement l’analyse de Bill Joy, cofondateur de Sun Microsystems et de son article dans Wired, « Why the future does not need us » (p. 397) qui éclaire cette problématique :
« À mesure que la complexité de la société et des problèmes auxquels elle doit faire face iront croissants, et à mesure que les dispositifs deviendront plus intelligents, un nombre toujours plus grand de décisions leur sera confié. Un jour les machines auront effectivement pris le contrôle. Les éteindre il n’en sera pas question. Étant donné notre degré de dépendance, ce serait un acte suicidaire point dans une telle société les êtres manipulés vivre on peut être heureux ; pour autant virgule la liberté leur sera clairement étrangère. On les aura réduits au rang d’animaux domestiques »
Pour compléter, il cite encore la réflexion du terroriste technophobe Unabomber alias Théodore Kazcynski, mathématicien brillant et sociopathe vivant dans une cabane. Et surtout le film 2001 où le cosmonaute finit par débrancher HAL, geste qui nous est désormais interdit et symbolisant pour lui notre degré de dépendance aux machines : « On ne coupe pas l’électricité dans un hôpital. L’humanité s’est laissée conduire dans un hôpital.«
L’information permettrait à celui qui la posséderait d’accomplir comme un superpouvoir, des choses jusque-là impossibles.
L’apogée (et dénouement/clé) de sa réflexion se situe dans sa 3e et dernière partie du livre, peut être la plus aride car se débarrassant presque complètement de son maigre déguisement romanesque pour verser quasiment exclusivement dans l’analyse technologique et philosophique. Cet effort ultime de lecture est toutefois récompensé par le dévoilement de l’ambition de l’auteur en particulier donc la restitution fictive de l’article scientifique « La singularité française » de Xavier Mycenne paru dans la revue Esprit (cité ci-dessus).
Il y livre une rétrospective de l’histoire socio-économique de la France et notamment de son approche de la « modernité » en mêlant notamment une analyse de l’histoire des idées, avec en particulier l’avènement dans les années 60/70 des philosophes structuraliste et linguistes (Derrida, Foucault, Deleuze) ayant intégré les mathématiques à leur pensée.
Finalement, Ertanger, animé de son nouveau but religieux, cherche à prouver « la nature miraculeuse de la théorie de l’information » mais plus largement la nature informatique de la terre entière qui agirait comme un supercalculateur où convergeraient enfin toutes ses lois physiques et thermodynamiques mises à jour siècle après siècle. « Pascal croyait à la théorie de l’information comme à une théorie religieuse. »
Il se lance alors dans des expéditions subocéaniques à la recherche de messages fantôme ressuscités d’un ancien câble télégraphique ou de missions de piratage spatial. L’objectif étant d’utiliser la biosphère marine comme vecteur chimique pour rétablir la communication, qu’il compare au fonctionnement du cerveau humain : « La terre entière de son noyau ferro-magnétique à ses derniers branchages de carbone, servirait d’instrument de calcul. Pendant les premières décennies de leur existence, les supercalculateurs avaient simulé la thermodynamique complexe de la Terre pour en modéliser l’évolution climatique. La Terre en tant que machine thermodynamique complexe, allait dorénavant pouvoir devenir elle-même un outil informatique. Elle ne serait bientôt plus qu’une tête de lecture, ou qu’un cerveau rêvant du reste de l’espace. »
Cette conquête de l’espace et de l’univers semblant en effet être un centre d’intérêt commun des milliardaires de Richard Branson (avec Virgin Galactic) à Jeff Bezos (avec Blue Origin) aux fondateurs de Google (Sergueï Brin et Larry Page).
De façon amusante, il imagine de la même façon que pour le biopic sur Mark Zuckerberg, qu’Ertanger termine son ascension et sa vie en reclus, alors que ces grands patrons ont tous dans la réalité fondé une ou même plusieurs familles et sont même parfois coureurs, mais il semble que l’imaginaire collectif aime à se les imaginer isolé, malchanceux en amour et asocial, en punition pour leur soif de pouvoir bien peu chrétienne 🙂 [Alexandra Galakof]
NB : Les numéros de pages indiqués pour certaines citations sont tirées de l’édition Gallimard, collection blanche du roman, parue le 22/08/2012, ainsi que de l’essai « Houellebecq écrivain romantique » paru aux Edition Léo Scheer en 2010













Derniers commentaires